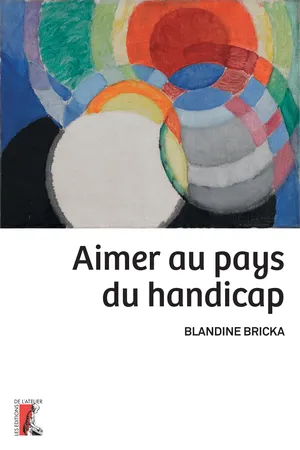![]()
Érika, psychologue,
Catherine et Tony, éducateurs spécialisés
« Laissons-les être parents »
Catherine : C'est dans le cadre du service d'accompagnement (SAVS){31} que j'ai pu observer toute l'évolution de l'accueil des personnes en situation de handicap, l'organisation de leur autonomie, leur mise en couple, leur désir de grossesse et leur parentalité. Nous avons ouvert un foyer en 1989. Quatre ans plus tard, pour permettre aux personnes du foyer les plus autonomes d'aller vivre en logements indépendants, on a créé un SAVS. Rapidement, des couples se sont formés et des enfants sont arrivés. Au SAVS, on consacrait alors beaucoup de notre temps aux couples avec enfants et aux interactions entre parents et enfants. C'était nouveau pour nous, et cela nous a demandé une approche complètement différente car au départ, nos missions n'étaient pas tournées vers le public de l'enfance mais vers les personnes adultes en situation de handicap. C'est là qu'on s'est dit que ce serait intéressant de créer des pôles différents : le pôle famille, consacré au suivi des familles ; le pôle personnes autonomes, dédié aux personnes célibataires ou en couple sans enfants ; et le pôle gestion des temps libres et des loisirs. À partir de là, on a commencé à avoir une réflexion plus posée et plus cohérente sur la parentalité et à développer des outils.
Érika : On a pu suivre des formations spécifiques sur la parentalité des personnes déficientes. Ce pôle famille répondait à deux objectifs : développer l'expertise des professionnels dans l'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap, mais aussi faire reconnaître cette parentalité, pour qu'elle ne soit plus ni taboue ni cachée. Car les collègues constataient souvent que les personnes ne disaient pas aux éducateurs qu'elles avaient envie d'avoir un enfant, parce qu'elles avaient peur de se faire disputer voire qu'on leur dise non ou qu'on leur demande d'avorter si elles tombaient enceintes.
Tony : Aujourd'hui, quand une grossesse se déclare, on attend que le couple nous en parle, mais en interne, on en discute déjà entre nous. En fait, dès qu'il y a couple, c'est un réflexe de questionner la vie affective et sexuelle, de se poser la question de savoir s'il y a contraception, s'ils sont à l'aise dans leur sexualité. Plus on anticipe, plus on fait de la prévention, plus on évite tout ce qui est déviances, cachotteries, tabous, les « on va pas le dire et on va le faire, mais pas dans les bonnes conditions ». Plus on leur permet d'avoir une liberté de parole, plus on se donne, nous, la possibilité d'avoir une place pour les conseiller.
Catherine : À partir du moment où on perçoit un désir d'enfant, on va donc essayer d'en discuter avec eux, spontanément au cours d'une sortie, d'une balade, d'un rendez-vous à domicile ou autour du projet personnalisé. On cherche à savoir si ce désir vient répondre à quelque chose de bien particulier, si c'est pour faire comme tout le monde. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là.
Érika : Me vient l'exemple de Géraldine et Ivan, avec qui j'ai fait récemment un entretien sur cette thématique du désir d'enfant. Ivan vient d'une famille où le nom est très très important et il voulait un Martin, comme lui. Un enfant qui fasse partie de ce clan. Géraldine, elle, a été placée bébé en famille d'accueil. Elle voulait revivre ce que peut-être elle avait vécu avec sa maman, sans qu'elle sache ce qu'elle avait vécu puisqu'elle a été placée. Malgré la déficience et nos craintes par rapport à une éventuelle parentalité, j'ai trouvé ça juste que comme tout un chacun, en lien avec leur histoire personnelle, ils aient ce désir-là pour ces raisons-là. Ensuite, c'est évidemment ce qu'on doit mettre au travail au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Parce qu'une fois qu'on a recueilli ce désir, la question est : qu'est-ce qu'on en fait dans la réalité ? Notre travail va être de contrebalancer le désir avec les compétences des personnes, soit qu'elles ont déjà, soit qu'il va falloir développer.
Catherine : À chaque fois, on est aussi amenés à donner des informations sur la loi, la mise en danger de l'enfant, les droits et les devoirs des parents. Il faut que les personnes sachent qu'il y a un risque de placement dans une famille d'accueil dès la sortie de la maternité, sans même de retour au domicile, ou de placement à la maison. Toute la complexité pour les travailleurs sociaux, c'est de trouver l'équilibre entre l'intérêt de l'enfant qui doit être en lien avec son père et sa mère tout en s'assurant que les parents garantissent la sécurité physique et affective de l'enfant. Mais une fois qu'on a donné toutes les informations, les conseils, la posture, on accompagne quelle que soit la décision. Parfois en faisant des virages. On s'adapte, on trouve les mesures adéquates à chaque étape, même si on est un peu réticents parce qu'on peut se projeter un peu plus et qu'on se dit que ça va être vraiment compliqué.
Tony : Il y a eu une évolution au niveau de la protection de l'enfance et de l'information préoccupante (IP){32}. Pendant longtemps, la loi n'a parlé que de l'intérêt de l'enfant et c'était déjà compliqué pour des parents défaillants sans handicap d'exister. Alors, quand il y avait un handicap ou une déficience, c'était quasiment mission impossible. On ne leur laissait aucune chance.
Catherine : Je dirais même qu'on était peut-être plus sévères vis-à-vis d'eux. Un enfant qui tombait de la table à langer était plus pointé quand les parents étaient en situation de handicap alors que cela peut arriver à n'importe quel parent de ne pas réussir à empêcher son enfant de tomber. On détaillait les manquements et toutes les lacunes plutôt qu'on ne cherchait à valoriser les compétences.
Tony : Aujourd'hui, de plus en plus, on cherche à remettre les parents au centre du projet, avec des mesures plus administratives que judiciaires, et des éducateurs qui viennent au domicile. Parce qu'avec le temps, la protection de l'enfance s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas travailler sans les parents et que quand il n'y avait pas de lien entre les parents et les enfants, le retour à la maison ne pouvait pas se faire.
Érika : Dans notre discours, on a évolué aussi entre le « on est un peu réticents » et le « on peut se laisser surprendre ». Parce qu'on a eu des expériences positives de parentalité où l'on s'est clairement fait surprendre par les compétences des parents que l'on ne présageait pas.
Catherine : Dans cette optique-là, on avait mis en place un partenariat avec une clinique qui a fermé depuis. On avait réussi à négocier qu'il y ait un temps d'observation plus long à la maternité, avec un point d'étape au milieu du séjour entre l'équipe de la clinique et nous, le SAVS. Observer les compétences de la maman, la complémentarité ou pas du papa, pour voir ce qui pouvait être mis en place pour la suite. On a beaucoup évolué sur cette parentalité à temps partiel qui peut être très bien autant pour les parents que pour les enfants. Au départ, cette possibilité n'était pas forcément dans notre tête au SAVS. On était quand même assez noir ou blanc : parents à temps plein ou parents avec enfants placés.
Tony : Aujourd'hui, les placements dès la naissance n'existent quasiment plus. En fait, tout dépend des familles et du profil de l'enfant. Parfois, dans une même famille, certains enfants vont être en famille d'accueil, d'autres en famille d'accueil spécialisée, d'autres dans des foyers type MECS{33}, ou ITEP{34}, d'autres à la maison. Quand l'enfant vit avec ses parents biologiques, on évalue ce qu'ils nous renvoient de leurs difficultés et ce que les partenaires du territoire dieppois peuvent nous en dire. On observe le développement de l'enfant. Si on voit qu'à 4 ans, le langage n'est toujours pas là, que l'enfant n'est pas du tout éveillé ou qu'on se questionne sur son comportement, forcément, on va commencer à interroger les compétences des parents et la pertinence du fait que l'enfant reste au domicile. Mais nous, au SAVS, on ne décide pas grand-chose. On va être le déclic. C'est la protection de l'enfance qui va évaluer et prendre une décision. Ensuite, on est là pour aider les parents à accepter ces décisions. Parfois aussi à se défendre, ou en tout cas, à verbaliser ce qu'ils n'arrivent pas forcément à verbaliser devant les autres partenaires.
Érika : On propose aussi des choses aux parents pour qu'ils puissent être plus disponibles auprès de leur enfant. Je pense notamment aux aides à domicile qui viennent par exemple faire du ménage. Ces interventions ne concernent pas directement la parentalité, mais ont pour objectif de rendre celle-ci plus qualitative. On a pu observer que le parent peut être débordé par ses enfants, par la maison, par le travail et quand il est d'accord, on va l'amener à réfléchir à comment être plus disponible pour son enfant en le délestant de tâches quotidiennes. Dans nos interventions du SAVS, on peut aussi proposer de la « guidance » : on observe le parent être avec son enfant et on va lui dire : « Tiens, là, tu aurais pu réagir autrement. » Ou : « Peut-être que là, ton enfant est en train de te dire quelque chose, qu'est-ce que tu en perçois ? » On propose aussi des groupes pour travailler avec les parents sur des thématiques comme le sommeil, l'alimentation, l'autorité, les câlins, les loisirs. À un moment donné, on faisait aussi des séjours famille. On partait en vacances avec eux pendant une semaine. C'était un temps de vie privilégié où il y avait à la fois des observations et des temps de guidance et d'échanges. Ça aidait à favoriser le lien de confiance avec les parents.
Tony : Pour ma part, je ne dirais pas que ces parents ont des difficultés particulières par rapport à d'autres. La spécificité, ce sont toutes les difficultés liées à la déficience...
Catherine : ... tout ce qui est abstrait, les dates, c'est compliqué...
Érika : ... faire appel à l'imaginaire, faire semblant...
Tony : Il y a des parents qui ne savent pas jouer avec leur enfant. On peut donc les sensibiliser au jeu : comment jouer, combien de temps, à quel moment de la journée.
Érika : Ce qu'on dit souvent aussi c'est que ces parents-là ont du mal à s'adapter à l'évolution de leur enfant. On a eu par exemple des parents qui avaient du mal à passer du mixé à l'alimentation en morceau.
Catherine : Je pense à une maman qui n'a pas vu grandir son fils et qui ne lui proposait toujours qu'une demi-pizza, alors que le mien, au même âge, mangeait une pizza complète. Un jour, je lui ai dit : « Il a faim ton enfant, il faut réadapter les parts. »
Tony : Ce sont des choses qui sont liées à la déficience, c'est-à-dire au manque de compétences dans des domaines précis. Par exemple, pour un papa ou une maman qui n'aligne que quelques phrases au quotidien, au moment où l'enfant va devoir développer des phrases, c'est compliqué pour lui d'aider son fils ou sa fille à le faire. On met ça en lumière parce que c'est lié à la déficience et qu'on connaît la déficience. Mais si on regarde bien, combien y a-t-il d'enfants qui ne verbalisent pas parce que les parents ne les ont pas aidés à verbaliser alors qu'ils ne sont pas déficients ? La conséquence sera la même, c'est la cause qui est différente. C'est en cela que notre service a dû se battre pour dire aux partenaires : « Attention, demandez-vous ce qui relève de la déficience et ce qui relève de la défaillance. » Pour certains parents, ce n'est pas de la défaillance de ne pas verbaliser, parce qu'eux-mêmes ne savent pas verbaliser. Si je ne sais pas lire l'heure, comment j'apprends à lire l'heure à mon enfant ? Pour autant, ces parents vont acheter suffisamment à manger, ils vont s'assurer que leur enfant a un toit, a chaud, a des vêtements, va à l'école, tout ce qui est matériel et relève des besoins primaires de l'enfant. Ce n'est donc pas la déficience qui fait devenir maltraitant ou, à l'inverse, un certain niveau intellectuel qui vous empêche de l'être.
Érika : Les parents déficients intellectuels, pour la plupart, ont ce qu'en psychologie on appelle la préoccupation maternelle primaire. Ils ont cet amour, ce lien très fort, cette intention de faire le mieux possible. Ça s'observe très clairement. Là où l'on doit être vigilants, c'est sur la question de la disponibilité. Il y a par exemple des parents qui, du fait qu'ils sont déficients, ne savent pas répartir leur attention. Il suffit qu'ils soient préoccupés par un conflit au travail et ils vont peut-être être moins sensibles aux besoins de leur enfant, parce qu'une partie de leur cerveau est préoccupée par autre chose. Mais, ça, c'est dû à la déficience. Quand il y a vraiment un souci d'attachement à l'enfant, on se pose plus de questions et on travaille avec les partenaires.
Tony : Pour le reste, on ne peut pas attendre des parents qu'ils sachent tout faire, et d'ailleurs, personne n'a eu des parents qui savaient tout faire. Mon père ne m'a jamais fait lire. Il est très bon en mathématiques, il me faisait faire des maths. Ça ne faisait pas de lui un mauvais père. Il y a des mamans qui vont apporter quelque chose de très affectif, des papas quelque chose de manuel. Là où l'on se positionne, c'est pour dire : « OK tu ne sais pas lire, mais tu sais faire d'autres choses. » Et surtout : « Tu ne sais pas lire, mais ça ne veut pas dire que ton enfant ne pourra pas lire. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ton enfant sache lire ? » On attend des parents qu'ils se rendent compte qu'il y a des ressources autour d'eux et qu'ils aillent solliciter les bonnes personnes au bon moment. Nous, on peut être le déclic de quelque chose. On a une maman qui a des difficultés avec la lecture et qui a des problèmes de diction. On ne comprend pas toujours ce qu'elle dit, mais elle est dans le souci que ses enfants soient scolarisés et soient, comme elle dit, « intelligents ». Elle est fière quand l'école lui dit : « Votre fille a bien fait ça. » Ça la valorise et elle est capable d'aller chercher un prof particulier et de payer des cours de soutien pour donner des chances à sa fille.
Érika : Quand on parle de parentalité à temps partiel, on parle aussi de tous les étayages et de toutes les personnes ressources qu'on peut mobiliser autour de l'enfant.
Tony : Dans tous ces accompagnements, on cherche à sortir de la posture de l'éducateur ou du travailleur social qui aurait la formule magique. Nous, notre outil, c'est notre tête, et on doit leur prêter notre boîte à penser. Ils vont avoir parfois des difficultés à concrétiser quelque chose, à aller au bout d'un projet ou à développer les techniques autour pour y arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à penser à leur place ou à penser pour eux. Ce serait très prétentieux de dire : « Nous, on sait comment on élève un enfant et on vient vous dire comment élever le vôtre. » Alors qu'on n'a ni déficience ni handicap et qu'on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu. Au fil du temps, on a pu constater qu'il y avait des familles pour qui ça avait très bien réussi, alors qu'elles n'ont parfois pas du tout (ou à peine) été accompagnées par le SAVS. On essaie donc de trouver des personnes déficientes qui viennent rapporter leur expérience positive aux parents qui sont peut-être un peu plus en difficulté ou qui auraient besoin d'être rassurés et mis en confiance. Et là, ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est une personne comme eux qui leur parle et, quand elle dit quelque chose, elle l'a vécu. Nous, ça nous permet de sortir de la surveillance et de l'autorité, du « tu dois faire comme ci et comme ça » et d'avoir une autre relation avec les parents ; de générer moins de défiance. Car au départ, le pôle famille, c'était quelque chose de très bien vécu. Mais au fur et à mesure, les parents ont compris qu'on pouvait aussi alerter quand on s'inquiétait pour les enfants. Pour certaines personnes en situation de handicap, avoir un enfant, c'était être comme tout le monde, faire partie de la société ordinaire, s'émanciper du handicap, de l'institution, de l'éducateur. Mais – retour de bâton –, parce que tu as des enfants et que tu es en situation de handicap, on te remet un éducateur. Au SAVS, il y a beaucoup de familles dont on ne s'occuperait pas s'il n'y avait pas d'enfants car les personnes ont largement les compétences pour vivre de manière autonome. C'est tout le paradoxe : leur projet, c'est l'autonomie, mais ce qui pour eux en est le graal – l'enfant –, c'est ce qui leur fait revenir un éducateur.
Catherine : Au départ, les parents nous percevaient vraiment comme un soutien mais à partir du moment où on s'est retrouvés, en tant que professionnels, à devoir interpeller les professionnels du territoire, parce qu'il y avait une suspicion de mise en danger, on s'est retrouvés dans un flou. Moi, je n'étais pas à l'aise pendant cette période-là. Je pense à une maman qu'on a accompagnée au SAVS. À l'époque, son fils avait 8 ans, – aujourd'hui, il est papa et elle, grand-mère. Elle avait été déchue de son autorité parentale et son fils placé. Quelques années plus tard, elle a eu un deuxième fils, Jim. Quand elle a quitté la maternité, on ne lui a pas laissé le temps de prendre ses repères et on lui a imposé d'aller tout de suite à l'ONM{35} qui devait évaluer ses capacités à s'occuper de cet enfant. Elle a fugué. Elle a été rattrapée, et l'enfant à son tour a été placé. Elle a pris un avocat, elle s'est battue pour le récupérer. Je me suis demandé ce qui se vivait dans les tripes de cette maman-là, comment elle traversait ces arrachements. Elle a eu un troisième enfant, une fille, cette fois. Quand elle m'a dit q...