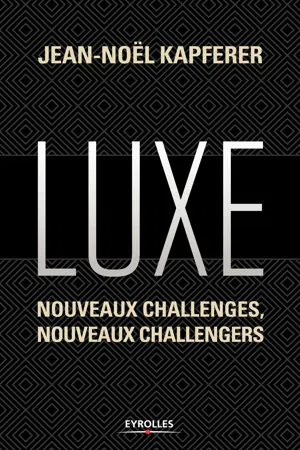![]()
Partie I
Concilier croissance et rareté
![]()
Chapitre 1
Entretenir le rêve du luxe
Au-delà de la rareté
Le luxe vend du rêve. Mais plus le secteur se développe — comme il le fait depuis le milieu des années 1990 — plus cela menace les leviers de ce rêve et l’essence même de ce qu’évoque la notion de luxe : la rareté et l’accès au privilège, à des produits et à une vie d’exception. Nous examinerons dans ce chapitre les principaux aspects de cette croissance du marché qui menacent le rêve inhérent au luxe et sa pérennité :
- le poids dominant des consommateurs chinois ;
- le rôle central d’Internet et des réseaux sociaux dans le comportement des consommateurs ;
- le floutage des frontières entre le luxe, la mode, les marques premium et celles dites de masstige ;
- les exigences nouvelles du développement durable.
Une industrie à nulle autre pareille
Le luxe vend du rêve. Les magazines de luxe publient régulièrement des articles dépeignant des lieux de rêve où l’on peut voyager, des maisons de rêve que l’on peut acheter, des yachts de rêve, des croisières de rêve, des voitures de rêve, des montres de rêve, etc. Sous la férule de son P-DG fondateur Bernard Arnault, LVMH, le premier groupe de luxe du monde avec plus de soixante-dix marques, vend des milliards d’euros d’articles qui promettent de « combler les espoirs et les rêves des consommateurs, etc., et ces rêves ne sont pas bon marché ». Comme l’expliquait Robert Polet, l’ancien P-DG de Gucci Group, devenu Kering, numéro deux du luxe mondial : « Notre métier, c’est de vendre des rêves » (Fortune, 6 septembre 2007). Gian Luigi Longinotti-Buitoni, P-DG de Ferrari North America, est le coauteur de Selling Dreams. Un article de juillet 2014 du Wall Street Journal était intitulé : « LaFerrari Is a Million-Dollar Dream ». Vendre du rêve est effectivement la mission essentielle du secteur du luxe et de ses marques.
La marque encapsule le rêve
Les marques jouent un rôle prédominant dans l’industrie du luxe. Les clients vont sur les sites Web de marques et entrent dans des magasins de marque. Pour conduire leur recherche, ils cliquent par exemple sur « Prada » et « Bottega Veneta », pas sur « sacs de cuir ». Le marché du luxe implique de ne pas se contenter de vendre d’excellents produits dans des endroits superbes en offrant un service irréprochable ; c’est la marque elle-même qui active et incarne l’élément intangible du rêve, l’accès symbolique à un univers spécifique de privilège, en franchissant un pas dans la stratification sociale, même de façon virtuelle. Royal Salute n’est pas simplement un whisky rare vieilli au moins vingt et un ans dans des fûts de chêne afin d’atteindre sa maturité ; il représente l’accès à un moment et à un univers hautement symboliques : le couronnement de la reine Elizabeth II, héritière d’une dynastie légendaire. Le 2 juin 1953, vingt et un coups de canon furent tirés par la Royal Navy et ce whisky rare fut offert en hommage à la souveraine.
Par extension, la marque Royal Salute est un hommage aux nouveaux rois et reines de l’époque moderne, c’est-à-dire les brillants entrepreneurs — partout dans le monde — qui ont bâti de nouveaux empires, entreprises et marques, particulièrement en Chine. Cette classe de « riches nouveaux » a besoin de trophées à sa hauteur, qui signalent son accession, son ascension, etc. Être consommateur de Royal Salute, c’est donc comme être membre d’un club très fermé. Bref, la consommation de produits de luxe comble des rêves et joue un rôle de stratifiant social. Elle permet de se mesurer les uns aux autres. Cette dimension d’accomplissement de rêve — autrement dit, l’accès symbolique à l’excellence et à une vie privilégiée, résultant des efforts que vous avez consentis et des choix que vous avez faits — c’est précisément ce qui sépare le luxe du premium. Il n’y a pas de rêve dans les meilleurs des vins californiens ou néozélandais, même ceux à 800 dollars la bouteille, qui sont de remarquables produits, premium. Au contraire, ouvrir un Petrus ou un Château Pape Clément, c’est entrer dans la légende, goûter un élixir fait d’histoire, de géographie, de culture, de temps, de savoir-faire, de vignerons, de châteaux, d’aristocratie, de clients royaux, de sacré... Ce qui ne veut pas dire que les grands bordeaux ne doivent pas se méfier aussi des vins premium qui travaillent sur leur produit.
Le secteur automobile compte de nombreuses marques premium, qui revendiquent toutes de construire « la meilleure voiture ». Le positionnement premium repose sur la possibilité de se proclamer la marque numéro un dans une catégorie donnée en fournissant divers éléments de preuve pour étayer cette assertion. La fonction prime sur l’acte de bravoure esthétique ou hédonique. Ces marques doivent en effet justifier leur prétention à être le premier de la classe. Dans un autre secteur, les publicités Lancôme affirment souvent que telle ou telle formule est la meilleure crème de soin en vertu d’une caractéristique, d’un ingrédient ou de performances uniques, que la concurrence est incapable d’émuler. Mais le luxe ne se résume pas à être le premier de la classe — il s’agit en fait d’incarner la classe elle-même à soi tout seul et d’afficher une suprématie symbolique. C’est la raison pour laquelle les marques de luxe semblent avoir les coudées si franches en matière de prix. Ce n’est pas le cas des marques premium, dont le prix est limité par la simple rationalité de leurs preuves ou par des tactiques de positionnement — Audi étant par exemple moins cher que Mercedes. Il en va ainsi des voitures premium, même super premium, qui vendent du « progrès » et donc, en filigrane, de l’obsolescence, toute version du progrès étant vouée à être remplacée par une autre. Les rêves, en revanche, ont une très grande longévité.
Une expansion continue malgré les crises
Une caractéristique frappante de l’industrie du luxe, c’est la constance de sa croissance sur le long terme, malgré les crises économiques, les récessions, les révolutions et les guerres. Selon Bain & Company, ce secteur représentait 1 044 milliards d’euros en 2015, dont 405 pour l’automobile, 253 pour des articles personnels (catégorie dite de « luxe personnel ») comme la maroquinerie, les vêtements, les montres, les bijoux et les parfums (contre 77 milliards d’euros en 1995).
La source de cet essor remarquable est la croissance économique mondiale elle-même. Bernstein Research a démontré que la croissance du luxe dans un pays est intimement corrélée à celle de son PIB. Rien d’étonnant à cela : la croissance découle du fait que les entreprises créent de la valeur et distribuent des salaires, et les dirigeants aiment savourer les fruits de leurs efforts. L’image de millionnaires pingres ou radins, qui épargnent toute leur vie mais ne jouissent jamais vraiment de leur fortune n’est plus d’actualité. Ce type de « riche » à l’ancienne, fort bien décrit dans The Millionaire Next Door ne représente pas le marché du luxe. Ni les très riches qui n’ont nullement besoin de démontrer leur statut, car ils l’ont déjà : ce sont des patriciens. La réalité de la croissance du marché du luxe repose non sur les riches mais sur les nouveaux riches, surtout ceux des pays émergents, dont la Chine fournit un exemple emblématique.
Dans ce pays, les chefs d’entreprise sont plus jeunes qu’ailleurs, et de nombreux millionnaires ont moins de 40 ans : ils veulent vivre comme leurs homologues occidentaux, bénéficier d’expressions similaires de richesse et de bonheur, par exemple la consommation de produits et de marques de luxe. Ils achètent des lofts, des appartements géants sur le Bund, à Shanghai, qu’il faut meubler. D’où le bond du marché du luxe dans toutes ses catégories (mobilier, peinture, décoration, arts de la table, etc.). L’expansion du secteur du luxe se fait après sur le haut de la classe moyenne qui souhaite imiter le style de vie de ses compatriotes riches et célèbres et des stars du monde occidental.
L’élément symbolique de ce type de comportement — et le plus facile à imiter — est la consommation de produits et de marques de luxe. Quand ces dernières ont commencé à être distribuées dans les pays émergents, le secteur du luxe y a décollé. En Chine, on dit que le marché du luxe est né avec l’inauguration à Shanghai de Plaza 66, le premier centre commercial de luxe. Le rêve devenait visible et accessible à tous ceux qui pouvaient et voulaient en payer le prix. De plus, comme le rappelait Thorstein Veblen, pour se faire admirer, être riche ne suffit pas, il faut le montrer. Avoir un yacht vous classe dans les UHNWI (Ultra High-Net-Worth Individuals), mais cela ne se voit pas, à la différence des biens dits de luxe personnel qui se portent sur soi. Le marché du luxe a donc crû du fait de la demande de biens très signifiants, voire positionnants, car ils classent hiérarchiquement leurs acheteurs. De plus, qui dit biens signifiants dit besoin de signalétique visible : d’où l’importance des logos. Nous reviendrons sur la problématique des logos et du « show-off » dans le chapitre 4.
Passé de 77 milliards d’euros en 1995 à 253 milliards de dollars en 2015, le marché du luxe personnel n’est manifestement plus le privilège de quelques rares personnes. La définition que le dictionnaire Webster a donnée du mot « luxe » de 1828 à 1913 rappelle de façon intéressante la façon dont le concept a changé : « tout ce qui plaît aux sens... et est également coûteux, ou difficile à obtenir ; un objet rare et cher » (voir http://www.webster-dictionary.org/definition/luxury). Certes, il ne s’est écoulé en 2015 que 7 000 Ferrari et 3 785 Rolls-Royce, mais Porsche a vendu 225 000 voitures dans le monde, et Audi 570 000 véhicules en Chine sur ses 1 741 100 ventes mondiales. Ces statistiques offrent une preuve supplémentaire que le secteur du luxe n’est plus, comme par le passé, composé que de petites entreprises de niche. Il représente un secteur macroéconomique à part entière, sous la direction de managers, avec des objectifs chiffrés considérables.
Rareté ou sentiment d’exclusivité ?
Contrairement aux autres secteurs économiques, cependant, la croissance y crée des problèmes, car le rêve du luxe repose en partie sur un discours de rareté et d’accès privilégié à des produits symboles d’une vie ou de moments d’exception. C’est ce que le concept du luxe évoque aujourd’hui aux yeux de ses consommateurs. Dans l’une de nos dernières études, nous avons interrogé 3 085 consommateurs jouissants de gros revenus de six grands pays (États-Unis, Chine, Japon, Brésil, Allemagne et France). Les répondants furent sélectionnés sur la base des achats qu’ils avaient déclaré avoir effectués au-dessus d’un certain montant et on leur demanda d’indiquer, sur une liste de dix attributs, ceux qui définissaient le mieux leur vision du luxe. Le tableau 1.1 révèle à la fois la convergence des définitions de ce qu’évoque le luxe pour ces clients et quelques différences idiosyncratiques entre les divers pays.
Il y a une similarité frappante entre ces résultats par pays et la définition ancienne du Webster, qui soulignait déjà l’importance du plaisir et du coût. Seuls les répondants chinois ont explicitement affirmé que le luxe évoquait à la fois le très cher et l’aspect exclusif, réservé à une minorité privilégiée de consommateurs, qui se distinguent ainsi de la masse. Il est vrai que les nouveaux riches Chinois ont voulu rattraper le temps perdu et leurs homologues occidentaux : ils entraient dans les magasins en demandant d’emblée le plus cher. Mais n’est-il pas normal quand on découvre un secteur, d’utiliser le prix comme signal de l’excellence ? Parmi les autres nationalités, les notions de rareté et d’apanage réservé à un petit nombre de privilégiés sont présentes, mais pas citées parmi les quatre premières associations ; elles sont plutôt perçues comme étant les conséquences ou les corrélats de la qualité, du prestige et du coût élevé des produits et des marques de luxe. Notons que le prestige renvoie implicitement à la marque, c’est elle qui porte le nom devenu prestigieux.