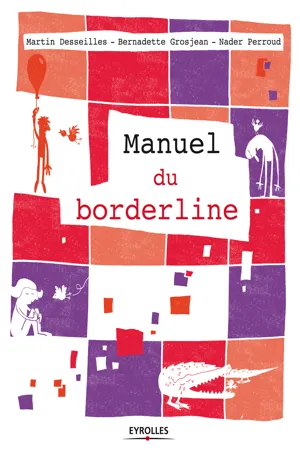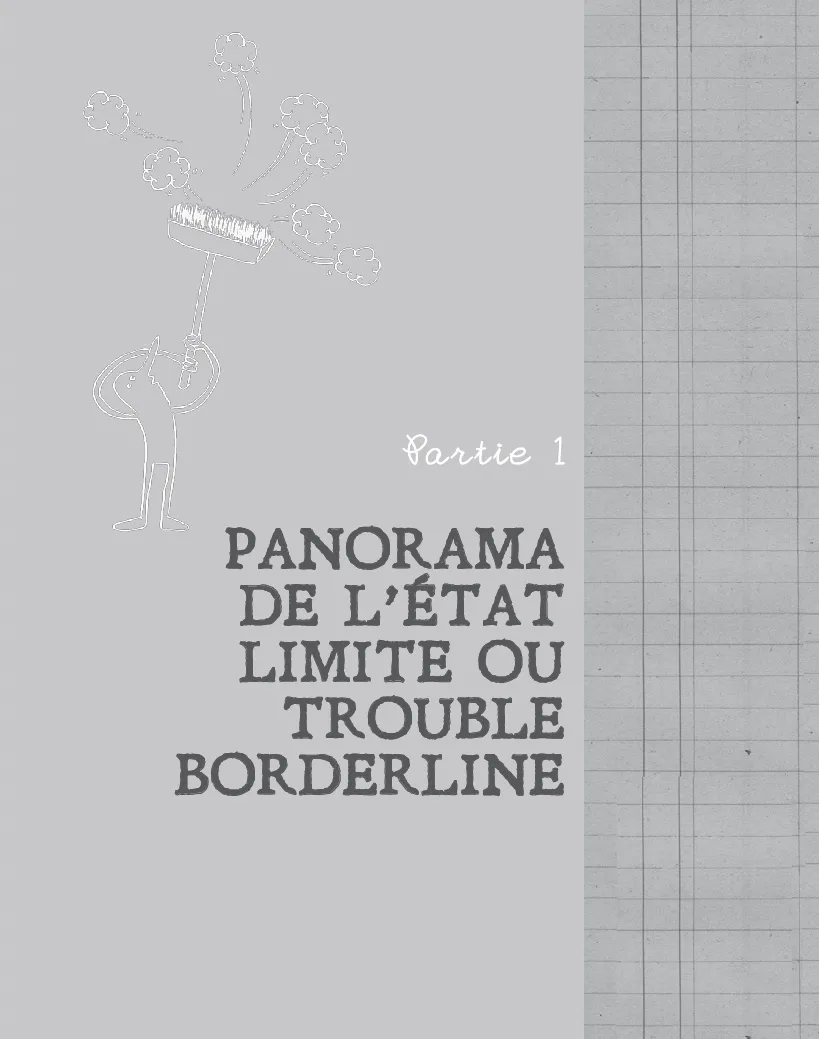![]()
![]()
![]()
Àla différence de « dépression » ou « anxiété », le terme borderline, littéralement « ligne de démarcation/frontière », est utilisé pour désigner un problème psychologique sans vraiment dire ce en quoi il consiste. Non seulement ce diagnostic ne signale pas un état particulier, mais le monde médical a longtemps associé à ce terme des expressions négatives comme « impossible à traiter », « difficile », « résistant », « manipulateur », voire « pas une vraie maladie ». Jusqu’à il y a peu, en effet, le diagnostic borderline, ou état limite, était considéré comme un grand fourre-tout dans lequel psychiatres et psychologues rejetaient celles et ceux qui ne répondaient ni à leurs catégories diagnostiques préétablies ni aux modalités de traitement classique (médicamenteux ou psychanalytique par exemple) qu’ils offraient.
Des mots pour des maux
Ne pas savoir pourquoi l’on souffre, pourquoi on fait des choses « folles », comme se couper pour arrêter d’avoir mal, est extrêmement angoissant. Quand en plus le monde médical déclare que l’on n’est pas un « vrai malade » mais juste quelqu’un de « difficile », c’est non seulement frustrant mais aussi cruel, car cela aggrave le sentiment de honte, d’isolement et de désespoir.
« On me dit borderline »
« Depuis plus de dix ans je me sens instable. Instable dans mes amours (je ne compte même plus le nombre de relations amoureuses que j’ai eues), instable dans mon travail (dès que mon patron “m’insupporte” je claque la porte et je vais ailleurs), instable avec ma famille (ils ne me comprennent pas et parfois ils me comprennent trop). Il m’arrive souvent de me blesser ou de boire énormément pour me faire mal. Ça me soulage et ça me fait peur en même temps. On me dit borderline, mais au fond je ne sais pas vraiment qui je suis. » Léa.
Depuis la nuit des temps, l’homme cherche à identifier les conditions psychologiques qui peuvent entraîner des souffrances et des problèmes au sein de la communauté et/ou chez les malades. Et pour ce faire il utilise des mots. Il y a plus de deux mille ans, Hippocrate parle ainsi d’« humeurs » pour définir les tempéraments ou caractères, et y associe des couleurs : rouge pour la colère, noir pour la mélancolie, etc.
Psychose, névrose
Le psychiatre allemand Emil Kraepelin (1856-1926) s’est efforcé, tout au long de sa carrière, d’établir une classification des maladies mentales fondée sur des critères cliniques objectifs. Dans la 6e édition de son Traité de psychiatrie publié en 1889, il utilise le terme psychose pour désigner les états psychiques caractérisés par une altération profonde de la conscience (trouble grave de l’identité, problème d’organisation de la pensée) et de son rapport à la réalité. Aujourd’hui, quand on parle de psychose chronique, on parle de maladies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire.
Qu’est-ce que c’est une névrose ? Le mot névrose a été créé par un médecin écossais, William Cullen (1710-1790) en 1777, et a été introduit en France un peu plus tard par le célèbre psychiatre Philippe Pinel (1745-1826). Ces deux médecins utilisaient le terme névrose pour désigner les maladies du système nerveux sans base organique connue.
En 1893, Sigmund Freud (1856-1939) choisit lui d’utiliser le terme névrose pour désigner un trouble psychique (hystérie, phobie, obsession, par exemple) généré par des conflits psychiques non résolus, refoulés, sans lésion organique qui « expliquerait » ce trouble psychique (à la différence de la syphilis ou d’une tumeur cérébrale par exemple). L’autre caractéristique très importante chez Freud est que le sujet névrosé, contrairement au sujet psychotique, reste conscient de sa souffrance psychique, du caractère parfois bizarre de ses symptômes, et qu’il vit donc dans la réalité. Si vous avez par exemple une phobie de l’avion et ne pouvez voyager par les airs, vous savez que cela n’a pas de sens, qu’il y a plus de risque à conduire sur l’autoroute, mais rien n’y fait. Il en va de même si vous êtes dépressif ou anxieux, vous avez parfaitement conscience de votre mal-être.
Qu’est-ce que c’est une psychose ?
On parle d’épisode psychotique quand, pour une période plus ou moins longue, les idées d’une personne, sa représentation du monde, son interprétation de ce qui s’y passe, sa compréhension de qui elle est, ne sont plus connectées (en partie ou en totalité) avec la réalité du monde et des gens qui l’entourent. Certains états psychotiques sont accompagnés de mouvements d’humeur très importants, avec des conséquences potentiellement dangereuses.
Dans la psychose, le patient a donc des pensées, convictions, comportements ou expériences « bizarres » qui ne sont pas basées sur la réalité. Il peut par exemple entendre quelqu’un qui parle quand personne n’est présent, ou penser que les journalistes télé sont capables de lire directement dans sa pensée et de partager avec tous les téléspectateurs ce qui se passe à l’intérieur de son esprit. Comme vous l’imaginez, cela peut être terrifiant.
Les maladies psychotiques les plus communes sont la schizophrénie et les troubles maniaco-dépressifs (ou bipolaires). Des états psychotiques peuvent aussi apparaître de manière plus brève sous l’influence de drogues (cannabis, hallucinogènes, amphétamines, etc.), lors de stress très importants, et même parfois comme symptôme d’une maladie médicale plus « classique » comme le lupus ou une infection.
Avec le temps, Kraepelin comme d’autres psychiatres et psychanalystes ont réalisé qu’il existait des patients dont la problématique et l’évolution étaient telles qu’on ne pouvait les classer ni dans la catégorie des psychoses ni dans celle des névroses.
Type de personnalité
Freud et ses collaborateurs décrivent toute une série de personnalités : dépressive, obsessionnelle, hystérique, introvertie, extravertie, etc. Une « personnalité » est ainsi déterminée en fonction de la manière habituelle dont quelqu’un se comporte, réagit, communique dans diverses situations, en particulier lors de stress ou de conflit intrapsychique.
Des psychanalystes ont observé que certains patients présentant initialement des problèmes émotionnels névrotiques comme de l’anxiété ou de la dépression, qui semblaient bien ancrés dans la réalité et avaient commencé une psychanalyse, avaient dû arrêter brusquement leur thérapie. En effet, après quelque temps, plus l’attachement au psychanalyste devenait fort – ce que l’on appelle le transfert –, plus le patient présentait des réactions inhabituelles comme des changements d’humeur très importants (l’expression « bruyante » d’amour puis de haine pendant la même séance), une pensée de plus en plus désorganisée, et devenait parfois carrément psychotique. Une personne habituellement calme et respectueuse présentait ainsi tout à coup des réactions imprévisibles et sans proportion apparente avec les événements qui les suscitaient. Pendant un moment plus ou moins long, plus aucune discussion raisonnable n’était possible, et le patient devait parfois être hospitalisé. L’interruption brutale de la thérapie était souvent traumatisante, pour le patient comme pour le thérapeute.
Claquer la porte du cabinet
Depuis plusieurs mois Astrid voit son psychanalyste quatre fois par semaine. Allongée sur son divan, elle raconte son enfance et les attouchements qu’elle a subis de la part d’un grand-oncle. Au fur et à mesure de la psychanalyse, Astrid s’attache de plus en plus à son psychanalyste, qui devient aussi essentiel pour elle que sa mère ou son père. Elle ne sait pas trop bien pour quelles raisons, mais une chose est certaine, son psychanalyste est extrêmement important pour elle, peut-être même « trop ». Un jour, alors qu’il lui annonce ses dates de vacances, elle se dispute violemment avec lui, l’insultant, jetant l’oreiller du divan à travers le bureau, et part en claquant la porte…
C’est l’une des raisons pour lesquelles ces borderlines, puisqu’il s’agit bien d’eux, avaient la réputation d’être « résistants », « difficiles » et/ou intraitables ! Il aurait sans aucun doute été plus approprié de dire que la psychanalyse classique (pas plus que la pharmacothérapie) n’était généralement pas suffisante pour les aider, mais, comme on le sait, il est parfois plus facile de blâmer la victime que de remettre en question ses convictions…
« Pseudo-névrotique », « pervers »…
Autre conséquence de ces cas d’évolutions cliniques dramatiques, certains patients ayant connu un épisode délirant sur le divan des psychanalystes furent peu à peu, une fois déclarés non névrosés, « reclassés » sous différents termes plus ou moins vagues comme « pseudo-névrotiques » ou même, plus tard, « pervers ». Or le choix d’un terme implique souvent une forme de jugement moral sur la détresse humaine que l’on souhaite définir. Quand on sait combien le fait de nommer quelqu’un peut influencer la manière dont il se perçoit (et comment la société le considère) et son entourage le traite, il est clair que cette manière de désigner les patients état limite ne faisait qu’accroître les sentiments de honte et de haine de soi déjà très présents chez eux.
Dans les hôpitaux psychiatriques de la première moitié du xxe siècle, les médecins firent une curieuse observation. Un certain nombre de malades hospitalisés pour une psychose parce qu’ils déliraient et commettaient des actes « insensés » guérissaient spontanément au bout d’un certain nombre de jours, de semaines, ou de mois. Ainsi, au lieu de sombrer dans un état de plus en plus psychotique, voire démentiel, comme Kraepelin l’avait décrit, ces patients se « reconstituaient psychiquement ». À une époque où les médicaments antipsychotiques n’avaient pas encore été inventés, une période de temps calme passée dans une structure organisée où des soins empathiques étaient dispensés semblait être suffisante pour aider ces patients à « sortir de la folie ». Ils ne présentaient bientôt plus de symptômes psychotiques, de velléités suicidaires ou automutilatrices et pouvaient quitter l’hôpital pour retrouver une vie « normale ».
Un univers menaçant
Louise est admise à l’hôpital en état de délire : elle a perdu contact avec la réalité et s’imagine que les services secrets l’espionnent. Des amis, inquiets de ne pas l’avoir vue assister aux cours et trouvant son attitude bizarre depuis quelques semaines, l’ont découverte dans son appartement, assise dans un coin avec le regard terrifié d’un enfant perdu. Près d’elle, des mégots de cigarette et des bouteilles de bière. À l’hôpital, pendant les premières 48 heures, Louise ne sort de son mutisme que pour déclarer des choses bizarres comme « ils vont me tuer », « je les ai entendus, ils marchaient tout autour, mon âme est perdue-dieu-djovan-djavu-perdu ».
Louise n’a jamais eu de suivi psychiatrique auparavant. Les examens médicaux et toxicologiques ne révèlent aucune particularité et, faute de savoir ce qui lui arrive, les médecins décident de la mettre en observation sans lui prescrire de médicament, sauf pour calmer les crises d’angoisse majeures. Au bout d’une semaine pendant laquelle on l’invite à dormir et manger à des heures régulières, Louise semble moins « paranoïaque ». Elle commence à parler avec d’autres patients, s’investit dans des activités musicales et, lentement mais sûrement, accepte de parler avec la psychologue, à qui elle confiera trois semaines plus tard un événement très traumatisant qui a eu lieu un mois plus tôt.
Vers la précision des caractéristiques du borderline
Faute de mieux, les psychiatres hospitaliers posent le diagnostic de « schizophrénie pseudo-névrotique » ou « schizophrénie ambulatoire ». Ils restent néanmoins devant un mystère : ces personnes souffrent énormément, parfois jusqu’au point de vouloir se suicider, et elles ont de grandes difficultés à contrôler leurs émotions. Certains psychanalystes commencent alors à s’intéresser de plus près à ces patients afin de mieux les comprendre.
Pensée en « tout ou rien », trouble de la régulation des émotions
En 1938, Adolph Stern (1879-1958), psychanalyste américain, écrit un article où sont décrites pour la première fois et en détail les caractéristiques propres aux patients « borderline », « état limite » en français, c’est-à-dire des patients se situant « à la frontière, ou à la limite, de la psychose et de la névrose ». Dans son article, Stern dit observer chez ces personnes un « narcissisme fragile », une hypersensibilité aux critiques et une tendance à tantôt idéaliser tantôt diaboliser les personnes importantes de leur entourage, thérapeute inclus. Une pensée en « tout ou rien » en quelque sorte. Il remarque également leur tendance à utiliser des mécanismes de défense psychique généralement utilisés par des patients psychotiques comme la projection, l’interprétation, le clivage.
En 1947, une autre psychanalyste, Melitta Schmideberg (1904-1983), avance qua...