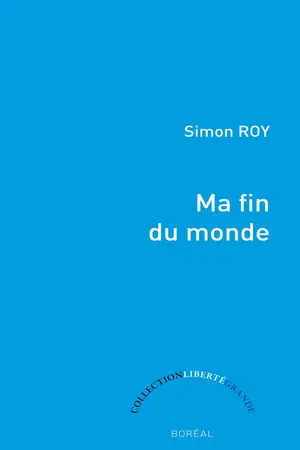![]()
LES DONS DE MICHEL
Un sang écarlate, couleur que j’appellerai des années plus tard « rouge Kubrick », pisse sur mon avant-bras droit. Je me suis coupé bêtement en essayant de sortir de la terre un morceau de verre brisé. Je ne suis pas dans un ascenseur d’un hôtel abandonné, mais dans le jardin du chalet de Sainte-Béatrix que ma mère a loué pour jouir des activités extérieures propices au lac Cloutier.
Ça coule, ça gicle quand j’appuie sur mon avant-bras, ça éclabousse jusqu’à mon vieux t-shirt bleu pâle des Scouts de Kansas City. Il ne sera bon que pour le bac à ordures quand je l’enlèverai. Je cours vers le lac pour y caler mon bras droit, pendant qu’en arrière de moi, à une dizaine de mètres, j’entends ma mère me criant : « Pense à mononc ! Pense à mononc ! » Je suis dans un état de panique et j’envoie même chier mentalement ma mère, moi qui suis d’ordinaire respectueux. Pendant cette quinzaine de secondes, Danielle Dufort insiste en m’enjoignant dans son apparent délire de me mettre vite à penser au mari de sa sœur Micheline, son beau-frère, Michel Ménard.
Sur le moment, je n’ai cure de penser à un oncle probablement en train d’effectuer son quart de travail à l’usine Firestone à Joliette (aujourd’hui la Bridgestone), à une trentaine de kilomètres d’où nous nous situons au moment de l’incident. Je n’ai qu’une idée obsédante en tête : arriver au bord du lac, mais l’injonction de ma mère fait manifestement son effet.
Le sang a bel et bien arrêté de couler. L’eau du lac se teinte de rouge, mais il s’agit du sang de mon t-shirt souillé, de celui qui colore mon avant-bras. Quand je regarde l’endroit de la coupure, il n’y a qu’une trace de blessure récente, mais pas de sang qui coule. Mon oncle Michel avait semble-t-il effectué son œuvre par une demande… – comment l’exprimer ? – télépathique, pourrais-je dire. J’étais et je suis encore aujourd’hui bien mystifié par cette guérison. D’autant plus que je n’ai invoqué mon oncle Michel d’aucune façon – le verbe invoquer m’apparaît au départ trop fort –, sauf que le fait que ma mère m’ait mis en pensée mon oncle par ses cris aurait suffi. Avec le temps, mon esprit rationnel a finalement pris le dessus. La blessure n’était peut-être pas si profonde ? J’ai assez vite rejeté l’idée d’une intervention surnaturelle ou, je lâche le mot, mystique. Mais ce cas m’est resté en tête longtemps. À preuve, j’en parle ici aujourd’hui, près de quarante ans plus tard, pendant que mon regard se tourne vers ma cicatrice qui est encore visible.
***
Michel Ménard a été pendant une trentaine d’années réputé pour avoir des dons. Un peu comme ceux de Zach ou de Madame Chose, personnages ayant chacun des dons de guérisseurs mystérieux dans l’excellent film réalisé par Jean-Marc Vallée, C.R.A.Z.Y., sorti en salle en 2005.
Mon oncle s’est en quelque sorte forgé sans le vouloir une réputation qu’il est difficile même pour des sceptiques endurcis et bornés comme moi de rejeter du revers de la main sans ressentir un trouble indécrottable. Tel un thaumaturge ou un guérisseur des grands chemins, il arrive à arrêter le sang des autres, que ce soit en personne ou à distance, par sa seule pensée.
Au début incrédule, j’en suis venu à accepter – pas à adhérer, mais à accepter néanmoins, dis-je bien – qu’il y a peut-être, je redis bien peut-être, autre chose que ce que nous croyons de visu. Peut-être y a-t-il, comme l’écrit l’auteur décadent de la fin du xixe siècle français, Joris-Karl Huysmans, des Là-bas, des forces qui sont inconnues du commun des mortels et que seuls quelques-uns d’entre nous peuvent entrevoir. J’avais, depuis l’épisode du lac Cloutier, la croyance molle, jusqu’à ce que les cas d’espèce qui se multipliaient souvent devant mes propres yeux viennent me faire fléchir.
Prenons le cas de mon fils, Colin. Quand il avait quatre ans, il a gagné un concours de coloriage de lapins et d’œufs de Pâques. Le trophée ? Un chocolat gigantesque. Il y en aurait eu suffisamment pour régaler une famille de douze enfants, comme au temps de mes grands-parents. La friandise étant trop grosse, même des jours après la semaine de Pâques, ma conjointe de l’époque a taillé en pièces plus petites le chocolat pour le mettre au congélateur jusqu’au temps des fraises, en juin, pour le manger comme dans une fondue improvisée.
Un soir de juin, donc, j’ai mis au four micro-ondes un bol de chocolat congelé. C’était un bol en porcelaine. Trente secondes pour faire fondre la friandise. Alors que je préparais dans la salle à manger les fruits pour le dessert chocolaté, la sonnerie du micro-ondes a retenti, et Colin s’est précipité tel un Hansel sur le four, retirant de ses deux petites mains le bol de porcelaine brûlant. Sa réaction a été automatique : sous la douleur, il s’est mis à courir comme un fou dans la pièce en hurlant. J’entends ses cris encore quinze ans plus tard, quand je repense à cet incident qui aurait pu avoir des séquelles permanentes. Je ne savais pas comment le soulager, comment le traiter, le soigner.
Mon premier réflexe intelligent aura été de le prendre dans mes bras, de l’asseoir dans la voiture, direction l’urgence de l’Hôpital de Saint-Eustache situé à une quinzaine de minutes de la maison. Les employés, entendant les cris, non, les hurlements de Colin, ont vite procédé – tant pis pour les procédures et le triage, on réglera cela plus tard – aux traitements qui consistaient à faire baigner la main blessée de mon enfant, recouverte de cloques. Mon fils continuait à hurler sa douleur vive pendant que le médecin s’affairait à lui mettre des onguents sur les plaies et à envelopper sa main de gaze stérilisée, un peu comme celle que se pose un boxeur avant d’enfiler ses gants. La douleur audible de mon enfant me déchirait de tristesse, mais je n’y pouvais rien. Mon petit boxeur avait été mis knock-out au premier round par un bol de porcelaine.
Quand nous sommes revenus à la maison, sa mère l’a consolé en vain, impuissante à soulager la douleur persistante de Colin. J’ai proposé d’aller le mettre au lit, en pyjama, et de le réconforter avec tout l’amour d’un père. Rien à faire, les hurlements ne tarissaient pas. Puis j’ai eu une idée sortie du bon vieux temps. Quand les procédés médicaux sont impuissants à soulager, il faut ou bien patienter pour que la douleur s’estompe d’elle-même (le temps faisant son œuvre, comme dit le cliché), ou bien opter pour une solution plus proactive qui nous apparaît jouable même si on ne croit pas tellement aux résultats positifs de la tentative.
« Pense à mononc ! Pense à mononc ! » J’entends dans ma tête ma mère me proposer une piste. Les dons de mon oncle Michel. S’il pouvait arrêter à distance le sang de couler par la simple pensée, peut-être arriverait-il à enrayer la douleur d’une brûlure, même majeure. Qu’avais-je à perdre de toute façon ? Colin allait sûrement hurler et pleurer toute la nuit, en attendant son prochain traitement à l’hôpital le lendemain matin.
— Qu’est-ce qui se passe, mon Simon ? Y a quelqu’un qui s’est fait égorger ? me demande au téléphone Michel Ménard avec son calme habituel.
— C’est Colin, il… il… il…
— Change de pièce, j’entends rien. T’as dit « Colin »… Quoi, Colin ?
Rendu au rez-de-chaussée, j’ai demandé à mon oncle, mon ange, s’il pouvait faire quelque chose pour soulager Colin. Au début, Michel n’a pas bien compris ce que je lui narrais. J’étais moi-même démuni, dans un état proche de l’hystérie. Il m’a demandé de reprendre mon histoire, mais plus calmement, en ne négligeant aucun détail. À la fin de mon récit, Michel m’a répondu :
— OK, c’que tu m’dis est précis, j’vais travailler à partir de ça. J’vais penser très fort à ton Colin.
— Mais… mais… mais…
Mon oncle avait déjà raccroché. Brusquement, selon moi, vu l’état de la situation. Je me suis dirigé vers la chambre de mon enfant. Ses cris avaient cessé. Il dormait comme un bébé, sourire aux lèvres, sa bonne main recouvrant celle blessée.
Le lendemain matin, Colin était tout joyeux, jouant en silence. Je l’ai emmené dans la salle de bain, j’ai déroulé ses pansements pour lui mettre l’onguent médicamenteux et je lui en ai appliqué des propres. Le téléphone a sonné, c’était mon oncle qui venait aux nouvelles. Je lui ai dit que nous ne retournerions pas à l’hôpital, car les traitements auraient été inutiles.
Je l’ai imaginé souriant sur s...