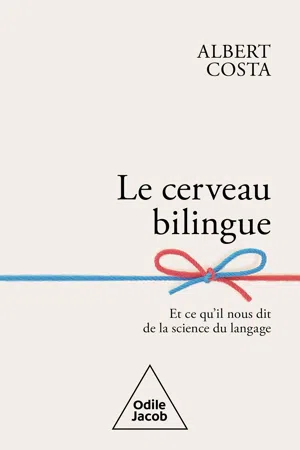
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
À propos de ce livre
Plus de la moitié de la population mondiale est bilingue. Pour le neurobiologiste et le linguiste, c'est un exploit et une énigme, car le langage humain est une faculté extraordinairement complexe. Comment deux langues peuvent-elles coexister dans un même cerveau?? Quels sont les avantages du bilinguisme?? Quelles sont les contraintes qu'il impose?? Albert Costa partage ici les résultats de vingt années de recherches. S'appuyant sur des études menées dans de nombreux pays, il montre comment des nouveau-nés font la différence entre deux langues, comment l'accent affecte la façon dont nous percevons les autres, pourquoi les bilingues sont meilleurs pour résoudre les conflits, comment on prend des décisions différentes selon la langue utilisée. Les surprises sont nombreuses?: il se pourrait même que le bilinguisme ralentisse les manifestations des maladies neurodégénératives. Illustration magistrale des applications des neuro- sciences et de la linguistique, ce livre alerte et plein d'humour explore les effets du bilinguisme sur le cerveau, les mécanismes de pensée et le comportement. Il laisse le lecteur étonné devant le pouvoir du langage. Albert Costa, neuropsychologue et linguiste espagnol de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, renommé mondialement pour ses travaux sur le bilinguisme, a disparu brutalement en 2018.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l'application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux forfaits: Essentiel et Intégral
- Essentiel est idéal pour les apprenants et professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la Bibliothèque Essentielle avec plus de 800 000 titres fiables et best-sellers en business, développement personnel et sciences humaines. Comprend un temps de lecture illimité et une voix standard pour la fonction Écouter.
- Intégral: Parfait pour les apprenants avancés et les chercheurs qui ont besoin d’un accès complet et sans restriction. Débloquez plus de 1,4 million de livres dans des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. Le forfait Intégral inclut également des fonctionnalités avancées comme la fonctionnalité Écouter Premium et Research Assistant.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l’application Perlego sur appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n’importe où — même hors ligne. Parfait pour les trajets ou quand vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sous iOS 13 ou Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l’utilisation de l’application.
Oui, vous pouvez accéder à Le Cerveau bilingue par Albert Costa en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences biologiques et Neurosciences. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Bilingues au berceau
Le deuxième opus de la trilogie Le Parrain narre l’arrivée de Vito Andolini aux États-Unis au début du XXe siècle. Vito est un garçon de 12 ans qui a fui, tout seul, sa ville natale de Corleone en Sicile. Après son débarquement à New York, Vito Andolini deviendra Vito Corleone, et ainsi débutera la saga des Corleone en Amérique. Je n’en dirai pas plus au cas où vous n’auriez pas vu le film. Ce que je peux néanmoins dévoiler, c’est que l’histoire personnelle de Vito Andolini partage des points communs avec celle de très nombreux immigrants qui ont foulé le sol des États-Unis au siècle dernier.
Entre la fin du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle, quelque 12 millions de personnes sont passées devant les agents de l’immigration du gouvernement américain sur une petite île située tout près de Manhattan : Ellis Island. La plupart de ces émigrants venus chercher un avenir meilleur en Amérique étaient originaires d’Europe. À leur arrivée à Ellis Island, ils devaient répondre à un questionnaire d’aptitude visant, entre autres, à déterminer leur pays d’origine, leurs ressources économiques et leur état de santé. Les plus chanceux ne passaient « que » cinq heures environ sur l’île avant d’être autorisés à entrer dans le pays ; ceux qui avaient moins de chance y passaient nettement plus de temps, étaient placés en quarantaine (tel fut le cas de Vito, car il avait la variole) ou renvoyés vers leur pays d’origine. L’un des personnages clés était l’interprète, qui avait pour mission d’aider les nouveaux arrivants à rédiger les formulaires d’entrée et à interagir avec les agents d’immigration. Son rôle était essentiel, car Ellis Island était en quelque sorte l’analogue moderne de la tour de Babel, où se concentraient des gens parlant une multitude de langues, de l’italien à l’arménien en passant par le yiddish et l’arabe. Les vagues d’immigration ont été si intenses qu’une bonne centaine de millions d’Américains, par leur histoire familiale, sont liés d’une manière ou d’une autre à des immigrants passés par cette île. C’est le cas de mon fils Alex, dont les arrière-grands-parents sont entrés aux États-Unis par Ellis Island. Une bonne proportion de ces migrants a réussi à prospérer et à fonder des liens familiaux durables. Pour qui n’a pas été forcé d’émigrer, pour des raisons économiques ou à cause de persécutions politiques, il est difficile d’imaginer ce que cela signifie d’arriver sur une terre inconnue et de devoir recommencer une nouvelle vie loin de son pays d’origine. Une chose en revanche est plus facile à imaginer, et c’est un défi auquel beaucoup d’entre eux ont dû faire face : il leur fallait apprendre une nouvelle langue.
Que signifie exactement « apprendre une langue » ? Apprendre une langue, ce n’est pas seulement mémoriser ses mots et sa grammaire, c’est aussi acquérir son système de sons (ce que les linguistes appellent les « propriétés phonologiques ») et apprendre l’usage approprié des expressions dans un contexte de communication précis (la « pragmatique » de la langue). Il ne suffit pas de connaître les étiquettes lexicales, c’est-à-dire les mots : nous devons apprendre aussi les sons de la langue, savoir comment les combiner, apprendre quelles constructions syntaxiques sont correctes, lesquelles ne le sont pas, savoir quel registre utiliser en fonction de l’interlocuteur qui est devant nous, etc.
Les migrants qui se retrouvaient à Ellis Island s’en sont vite aperçus : c’est un immense défi d’apprendre une langue étrangère. Arriver à la maîtriser comme un locuteur natif est un rêve quasi inatteignable si l’on ne commence pas très jeune. Adulte, il est pratiquement impossible d’acquérir parfaitement les sons d’une nouvelle langue et bien peu d’entre nous arrivent à se débarrasser de leur accent étranger. Il est difficile aussi d’acquérir des structures syntaxiques et, bien souvent, nos phrases contiennent des erreurs grammaticales. Par exemple, un Français voulant traduire « une carte » en espagnol pourra se tromper et dire « una mapa » au lieu de la formulation correcte : « un mapa ». Des aspects subtils du sens des mots nous échappent, et nous utilisons parfois des termes qui ne sont pas les plus adaptés au contexte de communication. Ainsi, on pourra commettre involontairement des impairs en employant des mots qui ont un double sens. À l’inverse, la similitude avec des mots de notre première langue pourra nous conduire à attribuer une signification incorrecte à un mot étranger. Ainsi, le mot espagnol constipado signifie « enrhumé », ce qui peut conduire à des situations cocasses devant un pharmacien. Finalement, il nous est difficile de coordonner toutes ces informations en temps réel et, même armés de suffisamment de courage pour démarrer une conversation dans une langue étrangère, le défi est énorme. Pourtant, aucun de ces obstacles ne résiste aux bébés, eux qui ont pourtant l’air de dormir toute la journée. Tous, nous sommes passés par ce stade, et tous, nous avons réussi à apprendre une langue, avec une certaine facilité – plus ou moins. Comment avons-nous accompli ce miracle ? Je n’ai pas pour ambition, dans ce chapitre, de fournir une réponse exhaustive à cette question. Plus raisonnablement, mon but est de vous présenter certains des défis auxquels sont confrontés les bébés, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir deux langues simultanément.
Les études que je vais présenter portent sur les processus d’acquisition au cours des premiers mois du développement du bébé. Ma sélection vise uniquement à illustrer les stratégies que les chercheurs utilisent pour découvrir les connaissances acquises par les bébés au cours de leur développement linguistique. Je mentionnerai des travaux effectués tant sur les bébés monolingues que sur des bébés bilingues. Ne soyez pas surpris par l’utilisation du terme « bébé bilingue ». Ces bébés ne parlent encore aucune langue – ils auront bien le temps de le faire plus tard –, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucune expérience. Dans de nombreux cas, l’expérience du bilinguisme commence bien avant que les bébés soient capables de produire des mots, d’où l’utilité de l’expression « bébés bilingues », car elle permet de différencier les nouveau-nés qui vivent avec deux langues ambiantes de ceux qui n’en ont qu’une. Donc, nous appellerons les bébés exposés presque exclusivement à une langue des « bébés monolingues » et les bébés exposés systématiquement à deux langues des « bébés bilingues ». Avant d’entrer plus avant dans le vif du sujet, il est important de souligner, si besoin est, que même quand les bébés ne parlent pas, leur cerveau fonctionne et traite en continu les informations de l’environnement. De nombreuses recherches ont établi qu’au cours des premiers mois de leur vie, les bébés acquièrent des connaissances très détaillées sur la (ou les) langue(s) ambiante(s). Par exemple, même s’ils ne commencent à parler qu’après la première année de vie (au plus tôt), dès six mois, ils sont capables de reconnaître un certain nombre de mots. Les études présentées ci-dessous se focalisent donc essentiellement sur la perception et la compréhension du langage plutôt que sur sa production.
Où sont les mots ?
Lisez la phrase suivante tirée d’un texte de Goethe, figure par excellence du romantisme allemand :
« Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. »
Ceux d’entre nous qui ne connaissent pas l’allemand ne la comprendront pas mais parviendront facilement à identifier les mots qui la composent : chaque chaîne de lettres encadrées par des espaces sera considérée comme un mot (« Wer », « fremde », etc.). Nous ne comprenons pas l’allemand, mais nous avons déjà fait un pas : nous devinons que « Sprachen » est un mot allemand, même si nous ne savons pas ce qu’il signifie. Maintenant, posez ce livre un instant et allez chercher dans votre bibliothèque musicale une chanson dans une langue que vous ne connaissez pas – tant mieux si elle est en allemand : le mot « Sprachen » apparaîtra peut-être et vous avez déjà gagné quelque chose. Écoutez-la attentivement, plusieurs fois si vous le désirez. Bien que vous ne compreniez pas le sens des paroles, êtes-vous capable de repérer les mots qui la composent ? Parvenez-vous à deviner où se trouvent les frontières entre les mots ? J’imagine que cela paraît impossible. N’abandonnez pas trop vite et essayez sérieusement de découper le flux sonore en mots. Je suis prêt à parier que, la plupart du temps, votre découpe ne correspondra pas aux mots ou aux éléments lexicaux. Cet exercice démontre que le signal de parole, contrairement à l’écriture, ne comporte pas d’espaces bien définis entre les mots et que, par conséquent, si vous aviez entendu la phrase de Goethe au lieu de la lire, vous auriez perçu quelque chose comme :
« WerfremdeSprachennichtkenntweißnichtsvonseinereigenen ».
Il est temps de briser le suspens, la phrase de Goethe signifie : « Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne sait rien de la sienne propre. » C’est précisément ce problème que rencontrent les bébés pour traiter les signaux du langage. Le problème est de segmenter le flux de parole en unités qui, par hypothèse, peuvent correspondre aux mots, et ainsi de construire leur vocabulaire ou lexique mental. Comment y parviennent-ils ? Et, dans le cas qui nous occupe ici, que se passe-t-il lorsque le continuum sonore à couper ou à segmenter peut appartenir à deux langues différentes ?
Des indices pour découper le flux de parole
Bien que ce soit une évidence, il peut être bon de rappeler que toutes les langues humaines peuvent s’apprendre. Si tel n’était pas le cas, c’est-à-dire s’il y avait une langue que les enfants humains ne pouvaient pas apprendre, elle disparaîtrait rapidement. Par conséquent, il doit y avoir dans le signal de parole un indice qui permet aux bébés de développer des hypothèses sur l’endroit où couper ou segmenter la parole. En d’autres termes, les chaînes de sons auxquelles ils sont exposés doivent présenter certaines régularités pour pouvoir guider la segmentation. Ainsi, on trouve dans toutes les langues des restrictions sur les sons qui peuvent être combinés. En espagnol, quand on entend la séquence des trois consonnes « str », on peut être sûr que le « s » marque au moins une limite de syllabe, et il est très probable que ce soit aussi la fin du mot ; c’est parce qu’il n’y a pas de mots qui se terminent par « st » ou qui commencent ou se terminent par « str1 ». De manière étonnante, dès 8 mois, et pratiquement sans aucune connaissance de la langue, les bébés qui apprennent l’espagnol savent déjà qu’après le son « s » un mot est probablement terminé. Comment est-ce possible ? Dans une étude scientifique qui a eu un fort impact, on a montré que les bébés étaient capables de calculer les probabilités de cooccurrence entre les sons. Cette étude mérite d’être décrite en détail, car elle nous aidera également à voir comment on parvient à explorer les connaissances que possèdent les très jeunes enfants.
Dans toutes les langues (humaines), la probabilité que deux syllabes (ou phonèmes) se suivent (dite probabilité transitionnelle) est plus élevée à l’intérieur des mots qu’entre les mots. Ainsi, par exemple, en espagnol, la probabilité que la syllabe « pa » soit suivie de la syllabe « la » est beaucoup plus élevée que la probabilité que la syllabe « bras » soit suivie de la syllabe « que », comme dans l’expression espagnole « las palabras que oimos » (« les mots que nous entendons »). En 1996, Jennifer Saffran et ses collaborateurs, de l’Université de Rochester aux États-Unis, ont mené une étude ingénieuse pour tester l’hypothèse selon laquelle les bébés de 8 mois sont capables de faire ce genre de calculs. Ils ont créé une séquence de syllabes entre lesquelles les probabilités transitionnelles étaient manipulées (voir figure 1). Certaines séquences de syllabes formaient ce que les chercheurs appelaient des « mots ». Pour qu’il n’y ait pas d’effet de la connaissance de la langue par les bébés – en l’occurrence l’anglais – ces mots avaient été inventés. La probabilité transitionnelle entre les syllabes à l’intérieur des mots était de 1 ou, si vous préférez, de 100 %. Par exemple, un de ces mots étant la séquence « tupiro », chaque fois que la syllabe « tu » apparaissait, elle était forcément suivie par la syllabe « pi », elle-même forcément suivie par la syllabe « ro ». Après la séquence « tupiro », il pouvait apparaître l’un des autres mots inclus dans l’expérience (« golabu », « bidaku », « padoti »), de sorte que la probabilité avec laquelle toute autre syllabe pourrait apparaître après « tupiro » était de 0,33, ou si vous voulez 33 % car après « ro », les syllabes « go », « bi » ou « pa » pourraient apparaître. En bref, la probabilité transitionnelle entre les syllabes de différents « mots » était beaucoup plus faible (seulement un tiers du temps) que la probabilité transitionnelle des syllabes à l’intérieur des mots, qui se produisait de manière déterministe. Des syllabes avaient tendance à apparaître ensemble très souvent et d’autres moins souvent. Les chercheurs ont fait écouter ces séquences de syllabes aux bébés pendant deux minutes, sans intonation ni pause entre les syllabes. En fait, la séquence était produite à l’aide d’un synthétiseur de parole artificielle et le résultat était similaire à ce que le lecteur pourrait ressentir en écoutant une chanson très monotone dans une langue inconnue.

Figure 1. 4 mots trisyllabiques ont été créés puis concaténés dans un ordre aléatoire, et synthétisés pour produire une longue chaîne sonore. Dans cette chaîne, lorsque « pi » apparaît, par exemple, il est toujours suivi par « ro ». Cependant, lorsque « ro » apparaît, la syllabe suivante peut être « go », « bi » ou « pa ».
Les bébés de 8 mois sont-ils capables de détecter ces régularités statistiques et de repérer dans la séquence de syllabes celles qui vont toujours ensemble ? Si le cerveau des bébés peut faire des calculs probabilistes, c’est-à-dire, ici, estimer les probabilités transitionnelles entre les syllabes, il pourrait alors se rendre compte que la séquence « tupiro » apparaît toujours ensemble (formant un « mot ») et que la séquence « rogola » apparaît moins souvent et ne forme donc vraisemblablement pas un mot. Cela indiquerait que les bébés sont capables d’exploiter les régularités statistiques présentes dans le discours comme stratégie de segmentation pour détecter des éléments lexicaux ou des mots2.
Tout cela est très bien, et j’espère que le lecteur conviendra avec moi que c’est aussi élégant que simple, mais… comment poser cette question aux bébés de 8 mois ? Eh bien on observe simplement comment, après avoir écouté la séquence de syllabes pendant deux minutes, ils prêtent attention aux stimuli trisyllabiques qui correspondent à des mots, aux autres stimuli, qui correspondent à des non-mots. Si les bébés réagissaient de la même manière aux deux types de stimuli, rien n’indiquerait qu’ils aient extrait les chaînes de syllabes qui apparaissent ensemble plus souvent et l’expérience ne serait pas concluante (et, bien sûr, si c’était le cas, je n’aurais pas entrepris de la décrire). L’expérience montre qu’en effet les bébés prêtent plus d’attention aux stimuli qui, dans la phase de familiarisation où ils les ont entendus d’abord, ne formaient pas des mots, qu’à ceux qui étaient perçus comme tels. Nous le savons parce que les bébés, en entendant ces stimuli, passent plus de temps à fixer la source sonore et sont moins distraits. C’est comme s’ils étaient surpris par ces stimuli qui, s’ils avaient bien été entendus lors de la familiarisation, n’avaient pas été segmentés comme des mots. L’origine d’une telle surprise réside dans le fait que les bébés se comportent comme des « machines statistiques » pendant la phase de familiarisation, calculant inconsciemment les probabilités transitionnelles entre les syllabes de la séquence monotone qu’on leur présente. Ce qui se passe dans leur tête doit ressembler à ceci : « Quand le son tu apparaît, il est très probable qu’il soit suivi par pi, puis ro ; ce motif qui se répète semble être une unité de quelque chose… un mot ; alors que si ro apparaît, il est peu probable que go apparaisse, donc la séq...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- Chapitre 1 - Bilingues au berceau
- Chapitre 2 - Cerveaux bilingues
- Chapitre 3 - Des conséquences de l’utilisation de deux langues - ou Comment le bilinguisme sculpte le cerveau
- Chapitre 4 - Le bilinguisme comme gymnastique mentale - ou Au-delà du traitement du langage
- Chapitre 5 - Décisions bilingues
- Lectures complémentaires
- Index
- Crédits des illustrations
- Remerciements
- Cahier photos
- Sommaire
- Collection