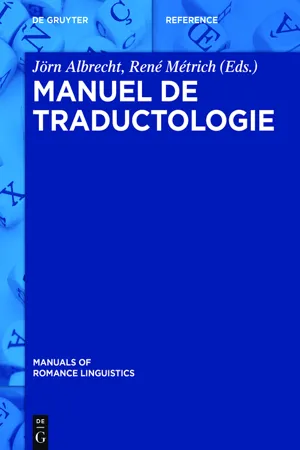![]()
Linguistique et procédés de traduction
![]()
Nelson Cartagena †
7Linguistique contrastive et traduction dans les pays de langue romane
Abstract : La présente contribution se fixe un double objectif : d’un point de vue général, elle vise, tout en restant concise, à brosser un tableau aussi complet que possible des principaux problèmes de la linguistique contrastive dans ses divers aspects, morphologiques, syntaxiques, lexicaux ou même phonétiques/phonologiques ; d’un point de vue plus particulier, elle souhaite rendre compte, de façon sinon exhaustive, du moins assez détaillée, de la multitude d’études publiées dans ce domaine dans les différents pays de langue romane.
Keywords : linguistique contrastive, stylistique comparée, comparaison de traductions, équivalence traductologique, équivalence statistique
1Introduction
Sur le développement de la linguistique contrastive (désormais LC), son objet, ses buts, ses fondements théoriques et ses méthodes, on consultera Cartagena (2001). La présente contribution se limitera à l’exposé des notions fondamentales de la LC, avec un double objectif : a) donner un aperçu des principaux thèmes développés par l’analyse contrastive, et b) justifier la sélection bibliographique relative aux différents pays de la Romania.
La LC consiste en une comparaison de langues en synchronie, sa tâche est de décrire les concordances et les discordances existant entre des langues particulières. La description des faits de langue à comparer précédant logiquement leur confrontation, la LC prend nécessairement appui sur les résultats de la linguistique descriptive. À cet égard, on peut affirmer que la LC ne possède aucune valeur méthodologique propre, les méthodes de description et d’interprétation des faits de langue devant être fixées avant la mise en contraste. Les structures étudiées doivent donc être d’abord identifiées pour chacune des langues en jeu et être dégagées selon les mêmes procédés. La nature de l’appareil descriptif utilisé est en soi indifférente ; toutes les approches sont par principe possibles – l’approche traditionnelle comme l’approche structurelle-fonctionnelle, l’approche générative-transformationnelle ou les approches pragmatiques ou textuelles plus récentes – pourvu qu’elles soient adoptées pour chacune des langues à comparer. Mais les résultats dépendent bien sûr considérablement du choix du modèle de description, de sorte que l’on peut affirmer d’un point de vue théorique et méthodologique que la structure même d’une langue ou du moins certaines de ses sous-structures se laissent mieux appréhender par tel ou tel modèle de description.
La LC et la linguistique comparée du XIXe siècle se distinguent par leur objet d’étude autant que par la perspective adoptée. En LC, le chercheur confronte des langues quelconques selon ses intérêts et ses objectifs. La linguistique comparée traditionnelle n’examine, quant à elle, que des langues apparentées. La première reste une discipline synchronique, tandis que la seconde remonte le cours de l’évolution historique des langues retenues pour tenter de reconstruire leur base commune, autrement dit la langue primitive dont elles sont issues. Cette perspective diachronique-génétique entraîne une focalisation sur les concordances, tandis que le caractère synchronique et l’histoire interne de la LC ont conduit cette dernière à privilégier les discordances. À mesure même que les disciplines issues du comparatisme, comme la romanistique, la germanistique ou la slavistique, abandonnent la perspective génétique-diachronique au profit d’une approche descriptive et systémique, elles fusionnent avec les domaines correspondants de la LC.
La LC et la linguistique typologique étudiant l’une comme l’autre les concordances et les discordances entre les langues, elles visent toutes deux à établir le degré de parenté formelle entre ces langues. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la prise en compte du type linguistique dans l’analyse contrastive est conditionnée par la perspective synchronique, alors que la typologie traditionnelle se veut plutôt « achronique », dans la mesure où elle a pour objectif d’établir et de caractériser des « classes de langues » comme par ex. les langues isolantes, agglutinantes ou flexionnelles.
La stylistique comparée est définie par Vinay/Darbelnet (21969, 32) comme une caractérisation de langues particulières par le moyen d’une comparaison : « [La stylistique comparative externe ou stylistique comparée] s’attache à reconnaître les démarches de deux langues en les opposant l’une à l’autre ». Mario Wandruszka, le principal représentant de ce courant, souligne ici le rôle de la traduction : « Toute comparaison de langues repose sur la traduction. Tout dictionnaire bilingue n’est rien d’autre qu’un condensé, un précipité de traduction ; toute grammaire contrastive n’est que de la traduction concentrée et systématisée »73 et propose pour cette discipline le nom de « Interlinguistik ».
L’émergence et l’importance grandissante d’une traductologie indépendante ces dernières décennies rendent indispensable sa délimitation d’avec la LC. À la différence de cette dernière, la traductologie est une science de la parole, en ce qu’elle porte d’abord sur les sens en discours. Mais les traductions échappent par ailleurs à la seule emprise de la LC, en ce qu’elles peuvent être étudiées comme partie intégrante de la culture cible. On trouvera des exemples, des précisions et des réflexions complémentaires sur les deux disciplines dans Cartagena (2001, 688s.), Schmitt (1991b) et Albrecht (2009).
2Domaines linguistiques et « tertium comparationis » (TC) en analyse contrastive (AC)
Si la LC a son origine dans la grammaire contrastive, le recours à la méthode contrastive a rapidement montré qu’une limitation à la dimension grammaticale de la langue ne se justifiait aucunement. La comparaison entre deux ou plusieurs langues peut parfaitement être conduite à tous les niveaux, phonétique, lexical, grammatical et textuel, comme le suggère fortement le fait que les correspondances entre langues s’établissent fréquemment entre unités appartenant à différents niveaux. Ainsi en estil par exemple des particules modales de l’allemand, dont les fonctions et les effets sont volontiers rendus dans les langues romanes, notamment à l’oral, par des moyens prosodiques ou lexicaux.
La comparaison interlinguale suppose la définition d’un tertium comparationis (TC), c’est-à-dire d’un système de référence qui permette la comparaison d’un même point de vue et en garantisse ainsi la cohérence. Il n’est, à l’évidence, pas possible de recourir à un système de référence unique pour toutes les dimensions de la langue, phonétique, syntaxique, lexicale, textuelle ou pragmatique. Il est donc non seulement utile mais indispensable de définir un TC spécifique à chacun de ces domaines. C’est ce TC que l’on appelle communément l’équivalence. Les TC les plus fréquemment proposés par les contrastivistes pour l’analyse contrastive sont :
Dans le domaine phonétique : les correspondances dans le domaine de la substance phonique. La phonétique articulatoire utilise pour ce faire l’alphabet phonétique international (API), la phonétique acoustique la théorie des traits distinctifs (ou mérisme, cf. Benveniste), qui opère sur la base de douze oppositions (Jakobson/ Halle 1962, 484ss.) : vocalique/non vocalique, consonantique/ non consonantique, compact/diffus, tendu/lâche, voisé/non voisé, nasal/oral, discontinu/continu, strident/mat, bloqué/non bloqué, grave/aigu, bémolisé/non bémolisé, diésé/non diésé.74
Dans le domaine lexical, le TC n’est autre que la réalité extralinguistique structurée par la langue. L’analyse componentielle est parvenue dans une large mesure à définir les unités lexicales comme des faisceaux de traits distinctifs minimaux, comme par ex. ‘animé’, ‘humain’, ‘liquide’ etc. On sait qu’un petit nombre de traits (dix-sept) suffit pour décrire 100.000 unités d’une langue particulière et que chaque langue ne possède qu’une partie de l’ensemble fini de ces traits. C’est sur cette base que la théorie des champs lexicaux conduit son analyse contrastive. La sémantique du prototype postule en revanche que les sens correspondent plutôt à des opérations de catégorisation naturelle hiérarchisée. À cet égard, Kleiber (1993, 83ss.) pose trois niveaux de profondeur différente : le niveau de base, celui des désignations courantes des objets et états de choses correspondant au prototype (par ex. arbre, chien), un niveau superordonné, qui est celui des concepts génériques (par ex. plante, animal) et un niveau subordonné, où l’on trouve les genres correspondant aux lexèmes de base (chêne, peuplier, tilleul ; dogue, épagneul, caniche nain).75
Dans le domaine de la grammaire, le TC repose sur des critères à la fois formels et sémantiques.
Prendre la ressemblance formelle des structures de surface, par ex. l’ordre des mots, les paradigmes flexionnels ou les schémas de composition des lexèmes, comme point de référence suppose évidemment l’existence de catégories analogues dans les langues mises en contraste. Les postuler par erreur peut conduire à des résultats trompeurs.
Quand le TC est d’ordre sémantique, ce sont des structures de surface formellement différentes qui sont présumées avoir le même sens. La structure complexe, multidimensionnelle du sens linguistique et les diverses conceptions que l’on s’en fait conduisent à des différences de form...