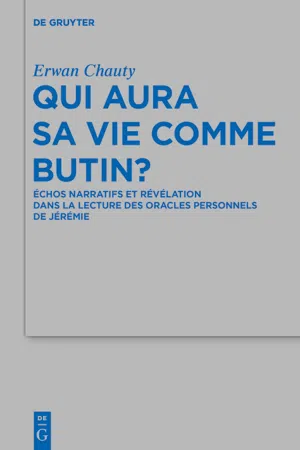1.1.1 Introduction
C’est à une lecture synchronique que l’on veut procéder dans cette étude, selon des principes qui seront exposés en leur temps. Ce n’est pas pour autant que l’on peut ignorer la domination de la perspective diachronique sur les études jérémiennes au XXe siècle. Certains, dans cette lignée, vont jusqu’à y voir la seule perspective possible, identifiant la voie synchronique à une démarche obscurantiste. L’argumentation de Robert P. Carroll, exégète reconnu de Jr, est typique de l’opposition au projet de cette recherche. Il vaut la peine de le citer pour montrer combien le chemin à parcourir n’est pas évident. Il écrivait ainsi il y a une vingtaine d’années :
« The only way I can rescue a synchronic reading is to do it in a diachronic way ! […] It makes sense of the untidy book of Jeremiah, it allows me to incorporate my post-Enlightenment critically reflective perspective into my reading of the text, and it seems to make due allowances for the discrete and diverse interests operating in the production of the text. »
« Perhaps a synchronic reading of Jeremiah can be sustained by postmodernist readers of the bible or by readers who resolutely refuse to recognize the Enlightenment as ever having happened in matters pertaining to reading the bible. »1
Serait donc en jeu la réception des Lumières, de l’avènement de la raison critique, incompatibles selon Carroll avec les lectures synchroniques. On pourrait peut-être se contenter de répondre en affirmant a priori la possibilité d’une lecture synchronique, la déduisant d’une réflexion herméneutique fondée en raison critique. On pourrait aussi se résoudre à affirmer la légitimité d’une diversité de méthodes, chacune ayant son domaine propre de validité, sans tenter d’ébaucher une articulation entre ces méthodes. On courrait alors le risque de considérer les méthodes comme étant universellement valides, indépendamment de l’objet sur lequel elles se penchent.
Mais il est une autre manière, pour qui veut tenter une lecture synchronique de Jr, d’aborder les études diachroniques. Synchronie et diachronie ne paraissent incompatibles que si elles sont présentées de manière trop schématique ; s’il est certain que les résultats de chaque méthode sont conditionnés par les questions spécifiques qu’elle pose au texte, une ignorance mutuelle des approches n’est pas satisfaisante. Chaque méthode exégétique, en effet, prétend rendre compte du sens du même texte – le texte massorétique considéré comme état final du processus de rédaction – et s’appuie sur des présupposés particuliers avec lesquels elle prétend entretenir un rapport critique : même si la science historique du XIXe siècle espérait mener une recherche parfaitement objective, on sait bien aujourd’hui que toute interprétation repose sur de tels présupposés. On se propose donc, dans la partie qui va suivre, de rendre compte de quelques études diachroniques majeures de Jr ; l’analyse ne portera pas d’abord sur leurs résultats, mais sur leurs fondements, souvent implicites ; elle ne visera pas une présentation objective, mais se concentrera sur ce qui touche au projet ici poursuivi. Dans ce but, l’étude de leurs introductions se montrera très significative ; on observera particulièrement le langage et les métaphores qui servent à chaque auteur pour penser ses résultats quant au prophète historique et à l’histoire de la rédaction : cela révèle des schémas de pensée. L’analyse ne sera pas menée pour elle-même, indépendamment du projet de cette recherche : l’argumentation ne se privera donc pas de détailler tel ou tel point, en fonction de son caractère significatif.
Dès à présent, on peut annoncer l’essentiel de ce qui ressortira : chacun de ces ouvrages s’appuie sur des préconceptions, concernant ce qu’est un prophète, ou ce qu’est un livre prophétique, ou sur l’herméneutique générale des livres bibliques. C’est l’écart entre Jr et ces préconceptions qui nourrit le découpage du texte en authentique et inauthentique, série de sources et de collections, traces de compilation, de réinterprétations, ou de corrections. Ce faisant, si ces commentateurs contestent la possibilité d’une lecture naïve, qui lirait le livre du début à la fin comme on le fait pour un livre moderne composé d’un seul trait en partant d’une feuille blanche, cela ne revient pas à affirmer l’impossibilité de toute lecture synchronique. Une bonne critique de ces présupposés, nettement manifestés dans les textes de ces auteurs, montrera que notre projet de lecture synchronique n’est pas rendu illégitime par l’exégèse jérémienne du XXe siècle, et qu’il ne se confond pas avec une démarche pré-critique. Sera ainsi peu à peu précisée une manière particulière de lire Jr synchroniquement, qui ne soit pas remise en cause par les travaux diachroniques ; ainsi se dégageront quelques acquis pour la construction d’une théorie narrative adéquate à Jr.
Les auteurs présentés le seront de manière chronologique, ce qui, malgré quelques inconvénients, présente des avantages. On court le risque, certes, d’induire l’idée que l’analyse narrative d’aujourd’hui – que cette recherche développera – doit justifier de sa légitimité en s’opposant à des approches dont certaines sont plus que centenaires. Cet anachronisme serait spécieux, faisant oublier que les travaux exégétiques ont progressé depuis ce temps. Si les questions lancées par les auteurs les plus anciens restent vives, leurs résultats ne s’imposent plus à personne aujourd’hui ; chaque génération reprend le travail non sur le mode d’un progrès linéaire ou d’une accumulation de la connaissance, mais d’un chantier sans cesse recommencé, habité par des questions qui se transforment au fur et à mesure de leur avancée. Pourtant, il vaut la peine de commencer par ces auteurs anciens : leurs prises de position implicites, distantes des manières d’aujourd’hui, apparaissent de manière plus vive ; surtout, elles sont à la source d’une incompréhension face à la possibilité d’une lecture synchronique qui traverse l’histoire et demeure aujourd’hui. L’ordre chronologique permet un autre avantage : même si l’on ne procèdera que par sondage, sans prétendre à l’exhaustivité, on parviendra à percevoir les mouvements de fond transformant l’exégèse historico-critique de Jr. On doit noter, d’ailleurs, que ces études s’appuient sur les résultats d’une recherche historique et archéologique qui progresse aussi : on connaît les révolutions2 produites non seulement par la découverte des manuscrits de Qumrân à partir de 1947, mais aussi après 1967 par les travaux de l’Archaeological Survey israélien, qui invalident la tendance très concordiste de l’archéologie biblique du début du XXe siècle. Après avoir cité les fondateurs de l’analyse moderne de Jr, puis quelques ouvrages majeurs universellement cités, on terminera par quelques travaux plus récents qui montrent la vitalité des études diachroniques de Jr aujourd’hui, ainsi que la persistance de présupposés envers l’analyse narrative. Une synthèse conclura cette partie, tentant de réfléchir de manière herméneutique aux observations dégagées ; elle préparera ainsi l’entrée dans la perspective synchronique.
Deux remarques s’imposent avant de commencer. On sait que les livres prophétiques ont souvent été qualifiés de vaticinatio ex eventu : ce qui permettrait au récit de mettre en scène un prophète dont les prophéties se sont réalisées, c’est d’avoir été écrit après les événements. Analogiquement, il en est de même pour l’emplacement dans cette recherche du parcours bibliographique : placé au début, il pourrait donner l’impression que l’exégèse de Jr qui suivra est en quelque sorte déduite de la bibliographie. Il n’en est pas vraiment ainsi, bien sûr : cette partie a en effet été rédigée en miroir des parties suivantes. Cela explique qu’on rendra compte des auteurs cités en portant une attention particulière à ce qui se révélera utile au projet exégétique poursuivi.
De plus, il importe de noter que ce qui suit n’est pas un jugement de valeur sur la démarche historico-critique, ni une présentation objective de son histoire et de ses apports indéniables – ce que ferait un ouvrage de type « commentaire ». Si le ton employé peut parfois paraître dur, c’est uniquement pour tenter de dégager une place pour le projet ici poursuivi, au milieu de ces monuments impressionnants. Le terme de « présupposés » est employé comme outil d’analyse, dans un sens que pourrait revendiquer une démarche de déconstruction, mais sans aucune valeur péjorative.
1.1.2 Duhm (1901)
Le commentaire de Bernhard Duhm3, publié en 1901, est habituellement présenté comme le point de départ des études critiques modernes sur Jr, d’où l’importance de repérer son rapport au texte final et aux processus qui y ont conduit. Duhm a initié le découpage du livre en plusieurs sources, ce en quoi il dépasse la tentative précédente de Carl Heinrich Cornill en 18954, qui avait réorganisé le texte hébreu selon un principe chronologique, mais sans l’accompagner d’une réflexion critique. Duhm, donc, affirme que le livre provient de plusieurs écrivains ayant travaillé au long de plusieurs siècles5. Il distingue les formes de prose, demi-prose, et poésie ; selon lui, seule la poésie est attribuable au prophète historique (p. VII). Attardons-nous sur une phrase de l’introduction, qui révèle la dynamique de son analyse :
« Das Endergebnis, dass nämlich dem Jeremia nur prophetische Dichtungen von einer bestimmten Form zuzuschreiben sind, aber keine Prosa oder Halbprosa, habe ich weder vorhergesehen, noch gar tendenziös herbeigeführt. Aber für mich bedeutet es die Befreiung von einem Albdruck ; ich glaube jetzt den Jeremia als Menschen, Schriftsteller und Propheten verstehen zu können, soweit man sich anmassen darf, das von einem so grossen Mann zu sagen. »6
On peut d’abord remarquer que la première justification indiquée de la position de Duhm est la mesure de son effet psychologique sur l’exégète : elle a produit en lui la libération d’un cauchemar (« die Befreiung von einem Albdruck ») ; dans les premières lignes de son commentaire7, il avait déjà décrit sa crainte initiale (« ich habe mich vor diesem Buch immer mehr gefürchtet ») face à Jr qu’il trouvait énigmatique (« rätselhafter »). Cette position repose sur deux mouvements opposés à propos de l’historicité : d’une part, attribuer à des rédacteurs ultérieurs plutôt qu’au prophète certains passages sur la base de leur forme littéraire (prose et demi-prose) ; d’autre part, chercher à connaître la personne historique Jérémie comme homme, écrivain et prophète. La recherche de la personne historique va donc de pair avec la qualification de nombreux passages comme non historiques.
La suite de l’introduction montre bien que Duhm raisonne à partir d’un schéma historique de dégradation progressive : ce qui est à l’origine est pur ; l’histoire ne peut ensuite que porter atteinte à la pureté première. Ce schéma, typique de la mentalité romantique de l’époque de Duhm, se révèle d’abord dans un concept d’évolution religieuse : il parle ainsi de l’ancienne et pure religion de Yhwh (« die alte reine Jahwereligion », p. XI), ensuite oubliée par la population. Il se révèle aussi dans sa manière de parler des responsables des états successifs du livre, d’abord Jérémie, dont le livre conserve les « poèmes prophétiques » (« die prophetischen Gedichte Jeremias », p. XI), puis Baruch, auteur d’un livre8 rapportant la vie du prophète (« die von Baruch geschriebene Lebensgeschichte Jeremias », p. X), enfin des « glosateurs »9 (« Ergänzer ») : alors que le prophète était « ein so grosser Mann » (p. VII), Baruch n’est ni un grand ...