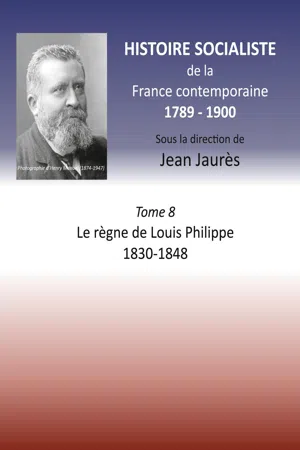![]()
Tome VIII
LE RÈGNE DE LOUIS PHILIPPE
1830-1848
par Eugène FOURNIÈRE
![]()
Première partie
La révolution bourgeoise
Du 30 juillet 1830 au 4 mars 1831
Chapitre premier
La révolution confisquée.
Les menées orléanistes et l’inertie de Lafayette. — Le manifeste et l’intervention des saint-simoniens. — Les deux centres de la Révolution : l’Hôtel de Ville vaincu par l’Hôtel Laffitte. — Les 221 offrent le pouvoir au duc d’Orléans. — Louis-Philippe, à l’Hôtel de Ville, joue la comédie républicaine. Le « fidèle sujet » de Charles X lance le peuple sur Rambouillet. — Tout est perdu, fors l’étiquette.
La bataille est terminée. Les Suisses et la garde royale se sont enfuis par les Champs-Élysées. A qui sera la victoire ? Ou plutôt qui en disposera ? Le peuple, qui vient de verser son sang à flots pendant ces trois terribles journées ? Non, cette fois encore son heure n’est pas venue. Le moment d’agir est venu pour le petit groupe d’hommes d’État qui ont observé de loin la bataille, après l’avoir allumée, volontairement ou non ; à présent que nul retour offensif du roi Charles X et de ses troupes n’est plus à craindre, les voici accrus en nombre et en audace, assez forts désormais pour s’interposer entre le peuple et sa victoire et faire que ce peuple encore armé ne se laisse pas entraîner à garder sa souveraineté reconquise. Il fallait qu’il se souvînt de la Révolution pour renverser un trône, mais non jusqu’à proclamer la République.
Deux hommes, entre autres, ont entrepris de limiter la Révolution : Laffitte et Thiers. Ils devanceront les rares partisans de la République et, d’une main aussi preste qu’habile, ils noueront l’intrigue qui doit placer le duc d’Orléans sur le trône. Le 30 juillet donc, les révolutionnaires victorieux peuvent, dès le matin, lire sur tous les murs une proclamation où Charles X est proclamé déchu et la République déclarée impossible, car « elle nous brouillerait avec l’Europe ». L’affiche continue en énumérant les mérites du duc d’Orléans qui « était à Jemmapes », qui « ne s’est jamais battu contre nous » et qui sera « un roi-citoyen ».
Thiers a rédigé cette affiche avec la collaboration de Mignet. Il annonce au peuple l’acceptation du duc d’Orléans « sans avoir consulté le prince qu’il n’a jamais vu », avoue M. Thureau-Dangin dans son Histoire de la Monarchie de Juillet. L’historien orléaniste n’insiste d’ailleurs pas autrement sur cette « audacieuse initiative », dont le succès effacera les périls et recouvrira l’immoralité. Il s’agit à présent de décider le duc, et sans retard. L’Hôtel de Ville est plein de républicains qui entourent Lafayette et le pressent de proclamer la République. Le peuple est tout prêt à se donner aux premiers qui se déclareront.
La Tribune, dont le directeur, Auguste Fabre, est républicain, pousse tant qu’elle peut à la solution républicaine. Dans son numéro du 29 juillet, elle dit bien qu’ « on entend encore dans Paris le cri de vive la Charte », mais elle ajoute aussitôt que « les braves citoyens qui poussent ce cri n’y attachent pas une signification bien nette, puisqu’il est suivi sur leurs lèvres du cri : Plus de roi ! Vive la liberté !… » Et suggérant la chose sans se risquer à lâcher le mot, la Tribune ranime les vieux souvenirs en ressuscitant le vocabulaire de la Révolution. « C’est, dit-elle, le cri de vive la liberté ! vive la nation ! qui doit se trouver dans toutes les bouches, comme sur toutes les poitrines les couleurs du 14 juillet, de Fleurus, d’Arcole et d’Héliopolis. »
La révolution avait deux centres : l’hôtel Laffitte et l’Hôtel de Ville. Les républicains avaient conduit le peuple au combat, et le peuple était encore sous les armes. Ils occupaient l’Hôtel de Ville, mais l’indécision de Lafayette y régnait, nulle résolution n’était possible qui n’eût pas eu l’assentiment du populaire héros des deux mondes.
En outre des communistes, héritiers de la tradition de Babeuf, membres des sociétés secrètes, et qui se trouvaient naturellement au premier rang des combattants, il y avait une école socialiste, celle des disciples de Saint-Simon. Quelle fut l’attitude de ceux-ci pendant les trois journées et, ensuite, dans le moment de trouble et d’incertitude où chaque parti tentait de dégager la solution de son choix ? Écoutons-les parler eux-mêmes. Écoutons Laurent (de l’Ardèche) dans la notice sur Enfantin qu’il a placée en tête des œuvres de Saint-Simon :
« Les apôtres du progrès pacifique avaient une rude épreuve à traverser, dit-il. L’ancien régime engageait un combat à mort avec la Révolution. Les disciples de Saint-Simon ne devaient pas se laisser entraîner dans cette lutte sanglante, bien qu’ils eussent la conviction d’être les adversaires les plus résolus et les plus redoutables du passé féodal et clérical qui s’était fait provocateur. Ils n’oublièrent pas, en effet, que leur mission n’était pas de détruire, mais d’édifier. Bazard, l’ancien membre de la vente suprême du carbonarisme, s’entendit à merveille avec Enfantin, l’ancien combattant de Vincennes, pour inviter les saint-simoniens à se tenir à l’écart de cette querelle fratricide. »
Dans la circulaire, adressée le 28 juillet « aux Saint-Simoniens éloignés de Paris », les chefs de la doctrine s’écrient : « Enfants, écoutez vos pères, ils ont su ce que devait être le courage d’un libéral, ils savent aussi quel est celui d’un saint-simonien. » Saint-Simon fut-il lâche pour avoir traversé « la crise terrible de la Révolution française avec ce calme divin qui eût été lâcheté, crime, pour tout autre que lui ? » Non. Les saint-simoniens, en présence des événements qui se déroulent, doivent être calmes, mais non pas inactifs. La période de la propagande n’a pas encore fait place à celle de l’organisation.
Pourtant, des saint-simoniens désobéirent. Si incomplète que fût la révolution qui s’opérait, ils estimaient qu’elle les rapprochait davantage de leur idéal que le règne de la Congrégation, Hippolyte Carnot, Jean Reynaud, Talabot, notamment, firent le coup de feu sur les barricades. Quant à ce dernier, il ne dut point, d’ailleurs, faire grand mal aux soldats de Charles X, car, nous apprend Laurent, il avait chargé son fusil la cartouche renversée, « de telle sorte qu’il ne put pas même la décharger en l’air en revenant ».
Dominés par le caractère religieux qu’Enfantin avait donné à leur doctrine, les saint-simoniens avaient bien renoncé à se battre, mais non à agir dans le sens de la révolution. Dans la soirée même du 29 juillet, le dernier coup de fusil à peine tiré, des réunions populaires se forment, notamment au restaurant Lointier, rue de Richelieu. Dans la réunion Lointier, Carnot et Laurent se joignent à leurs anciens amis les républicains, entre autres Buchez et Rouen, et protestent vivement contre la propagande qu’y font les amis du duc d’Orléans.
Puis avec Charles Teste et Félix Lepelletier Saint-Fargeau et deux saint-simoniens revêtus de leur uniforme de l’École polytechnique, ils s’en vont joindre sur la place de la Bourse un corps de volontaires de la Charte, composé d’environ quinze cents hommes et commandé par un polytechnicien, afin de les décider à se prononcer contre les menées des orléanistes. Ils rédigèrent à la hâte, sur le comptoir du magasin de librairie de Ch. Teste, une très brève proclamation qui commençait et finissait par ces mots : Plus de bourbons ! Lue aux volontaires, cette proclamation fut acclamée. Le bruit en vint à la réunion Lointier qui décida de stipuler, dans l’adresse envoyée à Lafayette et aux hommes de l’Hôtel de Ville, que toute candidature bourbonienne serait écartée.
Mais cela, de même que la démarche de Bazard auprès de Lafayette dont nous aurons à parler tout à l’heure, c’est de l’action officieuse. Les saint-simoniens se doivent de commenter l’événement qui a donné la victoire au peuple. Dès le 30 juillet, Bazard et Enfantin, dans une proclamation aux Français affichée sur les murs de Paris, glorifient l’insurrection victorieuse. Cela est pénible de les entendre crier aux Parisiens : « Gloire à vous ! » lorsqu’on sait que l’avant-veille ils ont blâmé ceux des disciples qui voulaient aller faire le coup de fusil aux côtés du peuple.
Le lecteur ne s’est pas mépris : Bazard et Enfantin n’étaient pas des lâches. Mais, comme tous les sectaires, qui veulent enfermer le monde et son mouvement dans la conception particulière qui les domine eux-mêmes, ils refusent de participer à une révolution qui n’est pas la leur, de combattre avec des hommes qui cherchent encore ce que, disciples de Saint-Simon, ils prétendent avoir trouvé. Pour que cette faute de nos aînés ait sa pleine utilité historique, pour que la leçon qu’elle contient ne soit pas perdue pour nous, pour que nul acte dans le sens du progrès général de l’humanité ne nous laisse indifférents désormais, pour que nulle marche en avant ne nous surprenne et ne nous oblige à l’humiliation de l’approuver sans y avoir pris part, écoutons les saint-simoniens au lendemain d’un combat où ils ne parurent pas et d’où ils éloignèrent ceux qui les suivaient :
« Français ! s’écrient-ils, enfants privilégiés de l’humanité, vous marchez glorieusement à sa tête !
« Ils ont voulu vous imposer le joug du passé, à vous qui l’aviez déjà une fois si noblement brisé ; et vous venez de le briser encore, gloire à vous !
« Gloire à vous qui, les premiers, avez dit aux prêtres chrétiens, aux chefs de la féodalité, qu’ils n’étaient plus faits pour guider vos pas. Vous étiez plus forts que vos nobles et toute cette troupe d’oisifs qui vivaient de vos sueurs, parce que vous travailliez ; vous étiez plus moraux et plus instruits que vos prêtres, car ils ignoraient vos travaux et les méprisaient ; montrez-leur que si vous les avez repoussés, c’est parce que vous savez, vous ne voulez obéir qu’à celui qui vous aime, qui vous éclaire et qui vous aide, et non à ceux qui vous exploitent et se nourrissent de vos larmes ; dites-leur qu’au milieu de vous il n’y a plus de rangs, d’honneurs et de richesses pour l’oisiveté, mais seulement pour le travail ; ils comprendront alors votre révolte contre eux ; car ils vous verront chérir, vénérer, élever les hommes qui se dévouent pour votre progrès. »
Ces paroles ne furent pas comprises, le peuple ne les accueillit que par l’indifférence la plus complète. Il n’avait pas vu au rude combat des trois jours ces hommes qui se proposaient pour organiser sa victoire. Aux rédacteurs de l’affiche qui lui disaient : « Nous avons partagé vos craintes, vos espérances », il eût pu répondre, s’il ne les avait profondément ignorés : « Mais vous n’avez partagé ni nos travaux, ni nos périls.
Car la vérité, les saint-simoniens l’avaient exprimée à leur mesure dans la circulaire du 28 juillet lorsque, parlant de ceux qui se battaient, ils avaient dit : « Ce sont des hommes qui cherchent avec ardeur ce que nous avons trouvé. » Le peuple et le parti libéral cherchaient en effet à achever la Révolution française, à en finir avec les vestiges de féodalité conservés et restaurés par Napoléon, puis par les Bourbons. Guidés par l’enseignement de Saint-Simon, Bazard et Enfantin affirmaient avoir trouvé la formule du monde nouveau : suppression de l’hérédité dans l’ordre économique comme la Révolution l’avait opérée dans l’ordre politique ; substitution du régime industriel au régime féodal et militaire ; prédominance de l’industrie sur la propriété foncière ; organisation d’une hiérarchie économique et sociale fondée uniquement sur la capacité et sanctionnée par l’amour. Voilà l’ordre nouveau que les saint-simoniens apportaient. Leur voix se perdit dans le tumulte des compétitions républicaines et orléanistes, et leur action fut moins remarquable encore que celle de certains libéraux qui intriguaient pour créer un courant en faveur du duc de Reichstadt.
La propagande faite en faveur du duc d’Orléans exaspéra les républicains réunis à l’Hôtel de Ville : « S’il en est ainsi, s’écriaient-ils, la bataille est à recommencer, et nous allons refondre des balles. » À vrai dire, il s’était formé autour de Lafayette, à l’Hôtel de Ville, un bureau de renseignements plutôt qu’un centre d’action, qu’un gouvernement. C’est que Lafayette, qui d’ailleurs toute sa vie reçut l’impulsion et jamais ne la donna, était à l’âge où l’initiative hardie est le plus rare. Béranger, aussi populaire que lui, croyait encore moins que lui à la possibilité de la République. Il n’y croyait même pas du tout.
Béranger était le poète de la bourgeoisie libérale. Sa pensée, comme son art, était juste-milieu. Il avait trop chanté la gloire de Napoléon Ier pour n’avoir pas un faible pour le jeune Napoléon II ; il avait trop chanté la liberté, chansonné les nobles et les prêtres, pour n’avoir pas un faible pour la République. Mais Napoléon II était prisonnier de son grand-père, ou plutôt de Metternich, à Schœnbrunn, et la bourgeoisie n’était pas républicaine. Béranger avait été aperçu dans un groupe d’orléanistes à la salle Lointier ; il s’était retiré dès que la majorité de la réunion avait manifesté sa préférence pour la République, et s’était rendu en hâte auprès de Lafayette, pour joindre ses efforts à ceux de Rémusat et d’Odilon Barrot en faveur du duc d’Orléans. Il fut certainement de ceux qui empêchèrent Lafayette de signer l’ordre de maintenir l’arrestation du duc de Chartres (fils aîné du duc d’Orléans) opérée par la municipalité de Montrouge au moment où le jeune prince tentait d’entrer dans Paris. Cet ordre avait été rédigé par Pierre Leroux, qui était le seul républicain du journal le Globe, où Cousin, Guizot, Rémusat avaient la haute main. Celui-ci avait achevé de paralyser Lafayette en lui disant : « Prenez-vous la responsabilité de la République ? »
Tandis que les républicains se débattaient à l’Hôtel de Ville contre l’inertie flottante de celui qui était pour eux un drapeau, non un chef ; tandis que les députés libéraux réunis chez Jacques Laffitte amusaient l’Hôtel de Ville et l’amadouaient, car il était hérissé de fusils encore fumants, — Thiers se rendait en hâte au château de Neuilly afin d’obtenir l’adhésion formelle du duc d’Orléans à tout ce qui se faisait en son nom dans Paris.
Il y trouva deux femmes : Madame Adélaïde, sœur du prince, et Marie-Amélie, duchesse d’Orléans. Quant au duc, il se cachait dans son château du Raincy, attendant les événements, sans doute aussi parce que Neuilly était trop proche de Saint-Cloud, où s’étaient retirées les troupes royales après le combat. Laffitte l’avait, en effet, invité à se mettre hors de portée des entreprises que la cour pouvait tenter sur lui.
Marie-Amélie accueillit fort mal le négociateur, ou plutôt les négociateurs, car Thiers s’était fait accompagner du peintre Ary Scheffer, ami de la famille d’Orléans. Elle accabla Scheffer de reproches pour avoir osé penser que le duc d’Orléans accepterait la couronne des mains de ceux qui l’enlevaient à son infortuné parent. Les deux ambassadeurs étaient assez embarrassés de leur personnage, lorsque parut madame Adélaïde qui leur fit un bref discours qu’on peut encore abréger, et fixer dans ce seul mot : « Réussissez ». Et elle envoya immédiatement un exprès au Raincy pour avertir son frère que la réunion des députés allait lui offrir le pouvoir.
Les 221 s’étaient réunis au Palais-Bourbon, dans la salle des séances, sous la présidence de Laffitte. De leur côté, les pairs s’étaient également rassemblés au Luxembourg. La Chambre (on peut lui donner ce nom, bien qu’elle eût déclaré n’être pas en séance) refusa de se prononcer sur la communication que lui fit M. de Sussy, de la part de Charles X, concernant la révocation des ordonnances et la désignation du duc de Mortemart, un libéral haï de la cour, comme président du conseil. Puis, sur la proposition du général Sébastiani, qui, nous apprend Louis Blanc, protestait le matin même que la France n’avait point d’autre drapeau que le drapeau blanc, elle offrit la lieutenance-générale du royaume au duc d’Orléans et vota le rétablissement de la cocarde tricolore. La réunion des pairs, qui venaient d’acclamer les héroïques résolutions de fidélité royaliste proposées par Chateaubriand, vota sans trop de résistance la proposition Sébastiani.
Le duc d’Orléans, averti du vote des députés et des pairs, et aussi de l’attitude des républicains de l’Hôtel de Ville, était rentré à pied, dans la nuit, au Palais-Royal, tandis que les délégués de la Chambre allaient à sa recherche. C’est là que le duc de Mortemart, envoyé par Charles X, le rejoignit. Remarquons ceci : la première personne que voit Louis-Philippe, ce n’est ni un républicain de l’Hôtel de Ville ni même un de ses partisans de l’entourage de Laffitte, mais l’envoyé du roi. Si celui-ci reprend l’offensive et triomphe de la révolution, il ne pourra imputer à son parent des démarches et des actes qu’il n’a pas même autorisés d’un signe. Si la révolution est victorieuse, rien à risquer non plus, puisque ceux qui sont à la tête de cette révolution travaillent pour lui bien mieux que s’il venait les gêner de sa collaboration. Nous le verrons, trois jours plus tard, alors qu’il a accepté officiellement la fonction de lieutenant-général du royaume, et virtuellement la candidature au trône, prendre encore ses sûretés au cas d’un retour de Charles X.
D’après le duc de Valmy, qui l’a publiée dans un ouvrage ultra-royaliste, car ce petit-fils de Kellermann fut un dévot de légitimité, voici le texte de la lettre que Louis-Philippe remit non cachetée au duc de Mortemart pour Charles X, et que le duc emporta dans un pli de sa cravate :
M. de… dira à Votre Majesté comment l’on m’a amené ici, par force : j’ignore jusqu’à quel point ces gens-ci pourront user de violence à mon égard, mais s’il arrivait (mots rayés), si, dans cet affreux désordre, il arrivait qu’on m’imposât un titre auquel je n’ai jamais aspiré, que Votre Majesté soit convaincue (mot rayé), bien persuadée que je n’exercerais toute espèce de pouvoir que temporairement et dans le seul intérêt de notre maison. J’en prends ici l’engagement formel envers Votre Majesté. Ma famille partage mes sentiments à cet égard.
Fidèle sujet. »
« Palais-Royal, juillet 31, 1830. »
Cette lettr...