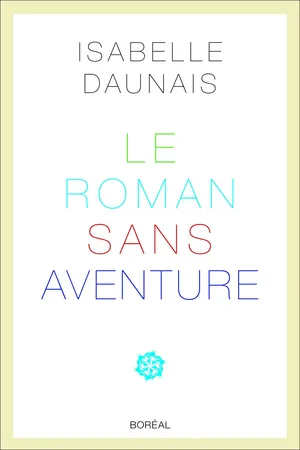Vivre en retrait du monde
De l’incipit célèbre de Prochain Épisode d’Hubert Aquin – « Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses » –, les auteurs de l’Histoire de la littérature québécoise suggèrent qu’il condense l’esprit même de la Révolution tranquille : « D’un côté, la révolution cubaine et la violence de l’incendie ; de l’autre, la quiétude d’un lac situé au cœur de la Suisse. Et les deux pôles symboliques sont renvoyés dos à dos au nom de la seule expérience qui compte véritablement, celle du sujet qui descend au fond des choses. »
Cette vision « dialectique » de la Révolution tranquille n’est pas fréquente. Dans le récit fondateur auquel elle a très vite donné lieu, comme dans l’image qu’elle a laissée dans les esprits, la grande entreprise de modernisation des institutions et des mœurs entamée au tournant des années 1960 et menée tambour battant jusque vers le milieu de la décennie suivante apparaît essentiellement et uniquement révolutionnaire. Personne n’ignore bien sûr que la transformation du Québec s’est faite en douceur, sans conflit ni obstacle. Mais plutôt que d’être examinée pour elle-même, plutôt que d’être vue comme une contradiction ou un paradoxe, bref, plutôt que de susciter l’interrogation, cette douceur est reversée sans procès au compte de la plénitude de l’événement. Loin de déceler dans cette expression antithétique (« Révolution tranquille ») la présence au moins possible d’un conflit ou d’une friction, nous voyons dans la « tranquillité » de cette « révolution » la preuve indiscutable de sa nécessité et de sa justesse. Que les grands « chantiers » d’alors, comme on dit, n’aient rencontré aucune résistance, sinon marginale, que les principes qui les sous-tendaient ne se soient vu opposer aucun contre-discours, sinon anecdotique, se présente à nos yeux comme le signe non seulement de leur force pratique, mais aussi d’une « vérité » qu’ils incarneraient, et qui explique qu’encore aujourd’hui les décisions politiques et institutionnelles prises dans les années 1960 et 1970 constituent l’aune à quoi nous mesurons toutes nos actions et pratiquement toute notre pensée.
Cette conception pleine et univoque que nous avons de la Révolution tranquille, par quoi nous ne la voyons pas comme un ensemble de phénomènes qui, mis bout à bout, lui donnent corps, mais comme un seul et même phénomène dont chacun des éléments est une facette ou un témoignage, n’est pas sans incidence sur la façon dont nous abordons la littérature de cette époque et des années qui la suivent. Nous avons en effet tendance à projeter la valeur de rénovation que nous associons à la Révolution tranquille sur tout ce qui lui a été contemporain et à faire de cette valeur une forme de raison supérieure. Par cette projection, la Révolution tranquille cesse d’être un événement qu’on explique à partir de faits observables pour devenir ce qui explique les faits observables. C’est ainsi que la littérature telle qu’elle se développe dans les années 1960 et 1970 est presque toujours présentée par l’histoire littéraire comme le produit de cette révolution, ce par quoi la modernisation du Québec se traduit dans le domaine de la création. Lues sous cet angle, les œuvres deviennent, sinon tout à fait, du moins prioritairement, des manifestations de l’énergie, du bouillonnement et de la liberté amenés par le grand vent de transformation qui souffle alors sur la société québécoise. Plus que tout, elles sont vues comme des marques de rupture, par quoi l’ancien fait place au nouveau, la tradition à l’innovation, le conservatisme au modernisme. Il ne s’agit évidemment pas de contester cette modernisation ni le rôle qu’a joué sur la littérature le passage accéléré du Québec à la modernité économique, politique et sociale. Mais on peut se demander si cette rupture par laquelle on définit les œuvres de la Révolution tranquille est la seule qui ait lieu, ou si elle est la plus importante. Car il existe aussi, au cœur de la littérature de ces années-là, et plus particulièrement au cœur du roman, une autre rupture, un autre passage, moins visibles que ceux qu’on associe au progrès de la société québécoise, et même contraires à l’idée de progrès (ou à l’idée courante qu’on se fait du progrès), mais tout aussi déterminants qu’eux.
Cette rupture est celle dont je pose l’hypothèse à la fin du chapitre précédent : après avoir cherché en vain, sans trop de souci à ses débuts, mais de façon plus austère et plus inquiète à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, un monde d’aventure, le roman québécois délaisse cette quête, dont il apparaît de plus en plus clairement au fil du temps qu’elle constitue une impasse. La difficulté, c’est que pour poser cette hypothèse et voir l’éclairage qu’elle peut apporter aux romans de la Révolution tranquille – et à la Révolution tranquille elle-même –, il faut faire l’effort d’aborder les œuvres en oubliant le discours qui les précède, à partir de ce qu’elles nous montrent, mais que ne permet pas de voir et même que cache le point de vue à partir duquel nous avons l’habitude critique de les lire. Certes, face à tout ce qui s’était écrit jusque-là, les œuvres des années 1960 ont indéniablement quelque chose de souverain qui rejoint l’esprit de la Révolution tranquille : leurs auteurs ne s’inquiètent d’aucune autorité venue du passé, ne craignent aucune forme d’innovation et de libération, que ce soit par l’usage du joual, le recours à des intrigues débridées ou l’invention de jeux narratifs de toutes sortes. Mais si cette souveraineté peut se rapporter à une volonté générale de s’ouvrir à des « temps nouveaux », comme on le chantait alors, elle a aussi une autre explication, qui ne se situe pas du côté de la révolution, mais plutôt de sa tranquillité. Car la tranquillité n’est qu’un autre nom de l’idylle, une idylle que le roman, cette fois, ne cherche plus à combattre, que ce soit par le rêve, la fuite ou l’attente, qu’il n’essaie plus de dépasser ou de percer, mais qu’il reconnaît, au contraire, qu’il accepte et, pour tout dire, à laquelle il s’abandonne.
L’abandon à l’idylle constitue – c’est l’idée que j’aimerais exposer dans ce chapitre – la grande ligne de force du roman de la Révolution tranquille. En fait, s’il y a « révolution » pour ce roman, s’il y a « rupture » dans ce qu’il fait et représente, celles-ci ne résident pas, ou ne résident que secondairement dans ses innovations formelles et ses usages nouveaux de la langue, dans ses thèmes et ses sujets, bref, dans ce que nous avons coutume de définir et de célébrer comme sa modernité. La révolution du roman québécois des années 1960 – révolution qu’on peut d’ailleurs définir comme une conquête, puisque ses effets n’ont jamais cessé de se prolonger – tient à un fait en apparence plus modeste que ces rénovations diverses, mais en réalité beaucoup plus profond et déterminant : son refus de poursuivre la quête d’aventure qui prévalait jusqu’alors ou, si l’on préfère, le fait que, face à cette quête, il lâche prise.
L’idée d’abandon, j’en conviens, va à contresens de tout ce qui nous vient spontanément à l’esprit lorsque nous pensons aux idées et aux œuvres de la Révolution tranquille. Dans notre imaginaire, nos repères, voire dans nos réflexes, la cause est entendue depuis longtemps : les années 1960 et 1970 marquent l’exact contraire de l’abandon et du lâcher-prise ; ce sont pour nous, que nous les ayons vécues ou non, des années d’action et d’entrée dans l’Histoire, de créativité et de réalisations sans précédent, de bonds en avant et d’expérimentations de toutes sortes. La cause est d’autant plus entendue que ces années donnent précisément le sentiment de l’aventure, qu’elles apparaissent comme le but enfin atteint d’une sortie de l’idylle. C’est d’ailleurs, on l’a vu, l’interprétation qu’en propose Pierre Vadeboncoeur dans La Dernière Heure et la première. Après deux siècles d’une « condition extrahistorique » qui lui avait permis de vivre « heureux » et « caché », « d’une chance rare dans la chronique de l’humanité », le Québec, écrit-il, accède avec la Révolution tranquille aux « conditions ordinaires de l’histoire » et, avec elles, à l’aventure : « Traditionnellement retranchés de l’histoire, il s’agit maintenant de nous lancer dans l’histoire. »
Mais si évidente et logique qu’ait pu apparaître cette façon de voir dans l’effervescence et les transformations du moment, et si attachés que nous y soyons restés au fil des ans, il n’est pas certain qu’elle soit tout à fait juste. Déjà, les années 1940 et 1950 avaient montré qu’on peut très bien se moderniser (arriver en ville, s’industrialiser, se mettre au diapason d’une culture et d’une économie en voie de mondialisation) tout en continuant de vivre « heureux et caché », et les années 1960, quand on les aborde dans l’optique du roman, montrent que cette continuité n’a été aucunement ébranlée, qu’elle s’est même, d’une certaine manière, renforcée. Il ne s’agit pas de nier la profondeur des changements vécus, mais de voir, derrière ces changements ou à côté de ces changements, ce qui ne se transforme pas, ce qui se poursuit, ce qui reste « tranquille », et que le roman, parce qu’il est toujours aux prises avec la réalité, permet justement de révéler.
Avant d’aborder les œuvres et de voir en quoi consiste cette révélation, il importe de répondre à une objection que l’on pourrait faire à propos de la spécificité, ou plus exactement de la non-spécificité, du roman québécois des années 1960 et 1970. On pourrait soutenir en effet, comme cela a été fait, que le renouveau associé au roman de ces années-là ne se rapporte pas tant à la Révolution tranquille ou à quoi que ce soit de local qu’au grand mouvement de transformation et d’expérimentation artistiques survenu de façon générale en Occident tout au long du XXe siècle et particulièrement à partir des années 1950. Même si c’était sur un mode qui leur était propre, les romanciers québécois n’auraient pas fait autre chose, foncièrement, que ce que les romanciers partout ailleurs faisaient déjà depuis longtemps et continuaient de faire, soit remettre en question le roman dit traditionnel, en particulier sa conception réaliste de l’intrigue et des personnages. La différence, c’est que, parti d’une forme particulièrement peu moderne, le roman québécois serait arrivé à cette remise en question de façon quasi instantanée : tel un marathonien qui, en un sprint inattendu, aurait rejoint tous les coureurs devant lui, il aurait comblé, en quelques miraculeuses années, le « retard » esthétique et thématique dont il souffrait jusque-là.
L’idée du retard comblé suppose toutefois que le sens de la marche ait été le même pour tous, c’est-à-dire que le renouveau procédait de la même question ou du même problème et visait le même résultat. Or rien n’est moins sûr. Si le roman québécois des années 1960 et 1970 a partagé, par certains aspects, l’évolution générale du roman, français notamment, il ne le faisait pas depuis les mêmes prémisses. Le cas du nouveau roman illustre de façon exemplaire cette différence de point de départ. Comme l’exprime bien l’idée de « soupçon » convoquée par Nathalie Sarraute pour en définir l’esprit, le nouveau roman marquait l’expression d’un sentiment d’épuisement face à tout ce que le roman avait exploré jusque-là, d’une lassitude face aux personnages qu’il lançait dans le monde et dont il suivait, comme autant d’énigmes, les ironies et les avanies. On connaît la célèbre formule de Jean Ricardou voulant que, « désormais », le roman ne soit plus « l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture ». Elle résume parfaitement la situation : le nouveau roman est un roman d’écrivains (et de lecteurs) revenus de trop d’intrigues et de récits, de trop d’actions à suivre et à décrire, de trop de reportages, et qui aspirent à un changement de régime : l’aventure ne viendra plus des aléas du monde, mais de l’écriture. Le roman de la Révolution tranquille n’opère pas, ne peut pas opérer depuis la même lassitude. Il n’est pas fatigué de l’aventure – comment pourrait-il l’être, alors qu’elle s’est toujours dérobée au roman avant lui ? –, il est, et c’est très différent, fatigué d’avoir à la chercher. La rupture esthétique qu’il constitue est en cela singulière, et sa trajectoire, en regard de celles dessinées par les œuvres du grand contexte, est une trajectoire distincte. Cela n’empêche pas qu’il y ait convergence et, à certains égards, superposition avec d’autres tracés, mais au lieu de rattrapage, il me paraît plus juste de parler d’une rencontre éphémère. Une rencontre qui explique pourquoi ce qui est souvent considéré comme l’entrée, avec les œuvres phares des années 1960, du roman québécois dans le grand contex...